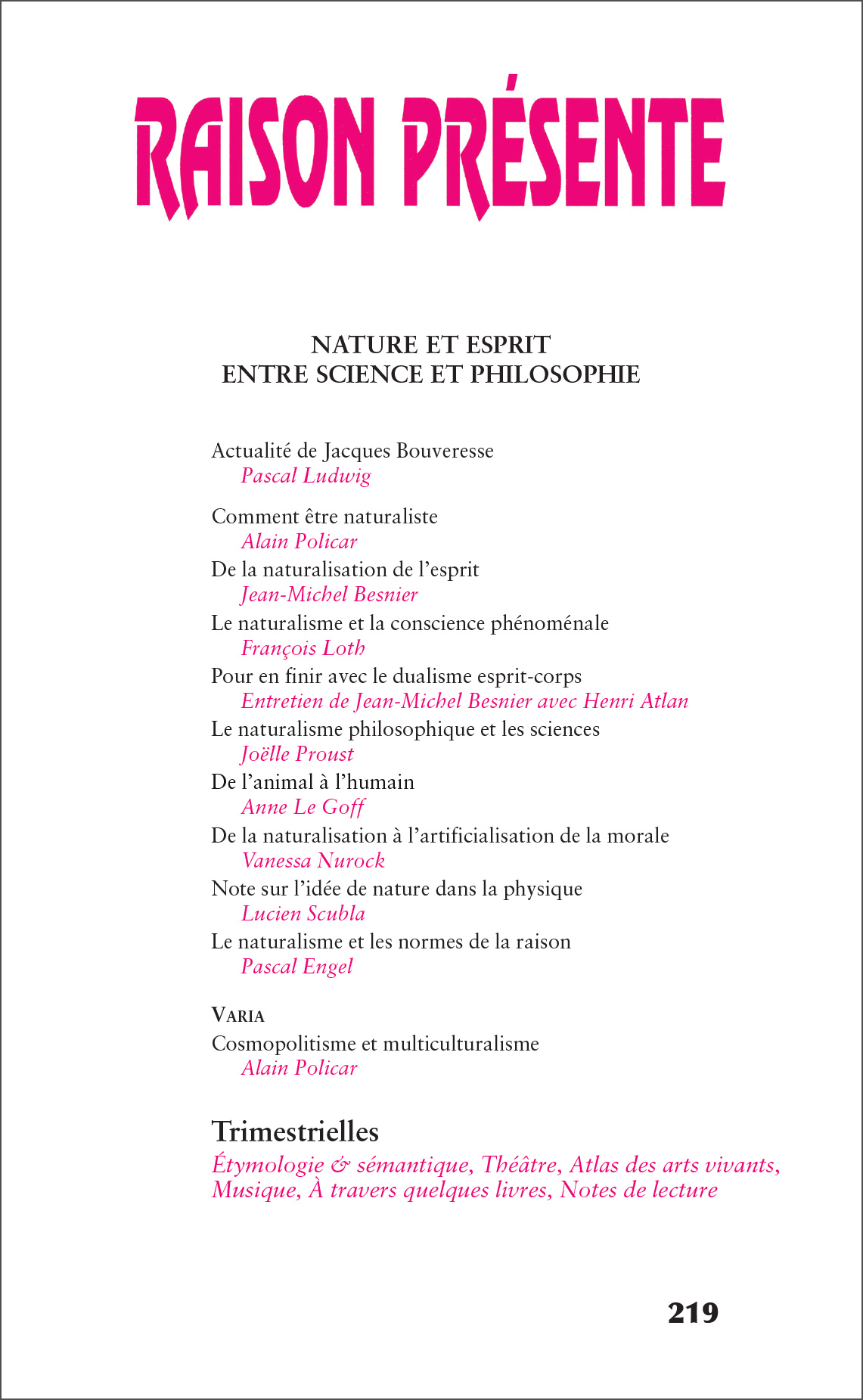Raison présente n° 219
19,00 €
Septembre 2021
NATURE ET ESPRIT
ENTRE SCIENCE ET PHILOSOPHIE
Sommaire
- Actualité de Jacques Bouveresse
Pascal Ludwig - Comment être naturaliste
Alain Policar - De la naturalisation de l’esprit
Jean-Michel Besnier - Le naturalisme et la conscience phénoménale
François Loth - Pour en finir avec le dualisme esprit-corps
Entretien de Jean-Michel Besnier avec Henri Atlan - Le naturalisme philosophique et les sciences
Joëlle Proust - De l’animal à l’humain
Anne Le Goff - De la naturalisation à l’artificialisation de la morale : un aller sans retour ?
Vanessa Nurock - Note sur l’idée de nature dans la physique
Lucien Scubla - Le naturalisme et les normes de la raison
Pascal Engel - Varia
Cosmopolitisme et multiculturalisme
Alain Policar - Trimestrielles
Étymologie & sémantique, Théâtre, Atlas des arts vivants, Musique, À travers quelques livres, Notes de lecture
Disponible en version numérique sur Cairn.info : https://www.cairn.info/revue-raison-presente.htm
NATURE ET ESPRIT
ENTRE SCIENCE ET PHILOSOPHIE[1]
Comment être naturaliste
Alain Policar*
La vocation d’une revue généraliste, telle que la nôtre, est de favoriser le dialogue entre les champs du savoir. Il n’est guère de question plus adaptée à ce dialogue que celle de la relation entre le mental (ou l’esprit) et le physique (ou la nature), laquelle se décline de multiples façons : on parlera des rapports entre états mentaux et états cérébraux, entre conscience et organisation neurobiologique ou encore entre intentionnalité et disposition cérébrale. Quels que soient les apports des auteurs contemporains, ils ne peuvent être compris sans se référer à la manière dont ces questions ont été abordées dans la philosophie du xviie siècle. Il est significatif de remarquer que dans son livre canonique de 1998, Mind in a Physical World (dont le titre résume parfaitement la problématique de ce dossier), Jaegwon Kim parle de la « revanche de Descartes ». Ou, plus surprenant, qu’un auteur, Daniel Dennett, pourtant hostile à ce qu’il nomme ironiquement le « théâtre cartésien », souligne sa dette à l’égard du philosophe français : « C’est en lisant les Méditations de Descartes que j’ai commencé à être fasciné par les problèmes des relations entre l’esprit et le corps »[2]. Et, en effet, comment ne pas l’être puisqu’il s’agit de se demander si l’on peut sauvegarder la causalité mentale, autrement dit l’idée que quelque chose de l’ordre de l’immatériel (une idée, une croyance, un sentiment…) produit un effet physique (un mouvement, une modification du corps…) ? Pourtant, la réduction du mental au physique est défendue par de nombreux auteurs pour lesquels les croyances et les désirs n’ont pas d’existence réelle. Nous avons pourtant l’intuition que nous sommes doués d’intentions et que celles-ci agissent sur le physique (elles sont dotées d’efficacité causale). Serions-nous victimes d’une illusion ?
Le fantôme De Descartes
Ce n’est pas l’avis de Jean-Michel Besnier qui, dans un article aussi limpide qu’érudit, s’emploie à sauvegarder la subjectivité, et donc à limiter le champ de l’enquête scientifique, en insistant, comme le faisait Descartes, sur l’expérience quotidienne de l’union du corps et de l’esprit. Et J.-M. Besnier n’hésite pas à réhabiliter l’« occasionnalisme » de Malebranche[3], de nature à faciliter l’essor de la raison scientifique par le privilège accordé à la formulation des lois au détriment de la recherche des causes. Mais il sait bien la tentative quelque peu désespérée devant la force des progrès d’une science du cerveau. Et s’il faut se résoudre à biologiser l’esprit, au moins, insiste-t-il, tenons compte de l’approche bergsonienne. Celle- ci, bien qu’opposée au dualisme cartésien, ne cède nullement au matérialisme réductionniste : si, parce que le vêtement tombe lors- que l’on arrache le clou sur lequel il est attaché, devrait-on penser que le vêtement et le clou sont la même chose ? Il existe donc des raisons consistantes de résister au réductionnisme ontologique et de défendre, à propos des activités cognitives, la concurrence des points de vue sémantique et neurophysiologique, concurrence qui plaide en faveur du dualisme des propriétés. Nous en reparlerons.
Si Descartes est, nonobstant la distinction substantielle entre l’esprit et le corps, ou entre leurs essences respectives, la Pensée et l’Étendue, l’auteur majeur, avec Spinoza, de ce que l’on nomme désormais philosophie de l’esprit, c’est sans doute en raison de sa théorie de l’union psychophysique : « Dans la même sixième Méditation où j’ai parlé de la distinction de l’esprit d’avec le corps, j’ai aussi montré qu’il lui est substantiellement uni »[4]. Cette union est fondée sur « l’hypothèse d’une localisation cérébrale de l’âme et sur le postulat de corrélations neuropsychiques »[5]. On comprend donc que, malgré la différence des substances, l’esprit est uni au corps, l’âme sise dans le cerveau. Autrement dit, la distinction substantielle du corps et de l’esprit, leur indépendance ontologique réciproque, laquelle signifie que « la connaissance de l’un n’est nullement requise pour la connaissance de l’autre »[6], n’exclut pas que l’esprit puisse ressentir ce qui se produit dans le corps. Comment concilier ces deux affirmations, celle de la distinction réelle et celle de l’expérience de l’union du corps et de l’esprit ? C’est, on le sait, l’objection énoncée par la princesse Élisabeth. Et la réponse de Descartes est assez déroutante : il ne lui semble pas que « l’esprit humain soit capable de concevoir bien distinctement, et en même temps, la distinction d’entre l’âme et le corps, et leur union ; à cause qu’il faut, pour cela les concevoir comme une seule chose, et ensemble les concevoir comme deux, ce qui se contrarie »[7]. Et dans la sixième Méditation, celle qui a joué un rôle décisif dans la vocation philosophique de Dennett (et très probablement de beaucoup d’autres), Descartes précise : « Il n’y a rien que cette nature (la complexion ou l’assemblage de toutes les choses que Dieu m’a données) m’enseigne plus expressément ni plus sensiblement, sinon que j’ai un corps qui est mal disposé quand je sens de la douleur, qui a besoin de manger ou de boire, quand j’ai les sentiments de la faim et de la soif, etc. […] La nature m’enseigne aussi par ces sentiments de douleur, de faim, de soif, etc., que je ne suis pas seulement logé dans mon corps, ainsi qu’un pilote en son navire, mais outre cela que je lui suis conjoint très étroitement, et tellement confondu et mêlé, que je compose comme un seul tout avec lui… Car en effet tous ces sentiments de faim, de soif, de douleur, etc. ne sont autre chose que de certaines façons confuses de penser, qui proviennent et dépendent de l’union, et comme du mélange de l’esprit avec le corps »[8]. N’avons-nous pas ici l’ébauche d’une neuropsychologie que ne perçoivent pas ceux qui réduisent Descartes au dualisme des substances ? On peut d’ailleurs, sans grande difficulté, repérer les rémanences du cartésianisme, d’un cartésianisme modernisé, c’est-à-dire sans le dualisme substantiel, dans la philosophie de l’esprit d’orientation cognitiviste, telle qu’elle s’exprime chez ceux qui assignent un lieu à l’esprit (l’intériorité), qui attribuent à cet esprit un fonctionnement représentationniste et qui, enfin, admettent la thèse de l’interaction entre le mental et le physique.
Il n’en reste pas moins vrai que Descartes ne fournit pas de réponse satisfaisante à ce que l’on nomme désormais le Mind-body problem. Mais il a l’immense mérite d’ouvrir la voie, par les critiques qui seront adressées au modèle de l’action réciproque[9], à une représentation concurrente du mental. Il fallait exposer les grandes lignes du modèle cartésien pour comprendre les débats ultérieurs et, notamment, la signification de la théorisation spinoziste.
Fécondité du modèle spinoziste
Pour mesurer cette fécondité, nous bénéficions ici d’un guide exceptionnel. Dans l’entretien qu’Henri Atlan a accordé à Jean-Michel Besnier, la radicalité de Spinoza (et sa modernité) apparaît clairement : si l’interaction entre le corps et l’esprit est impensable, il convient d’éliminer le problème. Dans le cadre de l’ontologie spinoziste, la dualité substantielle n’existe pas : il n’existe qu’une substance (monisme ontologique) et la pensée et l’étendue en sont les attributs. Dans la mesure où la substance possède deux types de propriétés, les mentales et les physiques, les premières n’étant pas réductibles aux secondes, on a pu parler de dualisme des propriétés. La théorie du double aspect, dont Spinoza est à l’origine, admet donc l’existence d’un point de vue subjectif irréductible à l’approche objectiviste. C’est ce qui justifie la distinction d’H. Atlan, sur laquelle J.-M. Besnier attire précieusement l’attention, entre réductionnisme ontologique (qu’il réfute) et réductionnisme méthodologique, lequel est inhérent à la démarche scientifique.
Dans cette optique, on accordera un intérêt particulier à la façon dont H. Atlan rapproche de Spinoza un auteur contemporain majeur, Donald Davidson. L’œuvre de ce dernier est désormais assez bien connue en France grâce au travail de traduction et d’analyse de Pascal Engel. Son monisme anomal pose que les êtres humains sont des systèmes physiques (monisme), mais il n’en résulte pas que l’on puisse développer une « psychophysique », car les conditions d’identification de l’état mental d’un individu ne coïncident pas avec les conditions d’identification de son état physique (anomalisme). Autrement dit, les raisons de vivre ou d’agir ne peuvent relever d’une explication naturaliste (par des lois), mais d’une explication intentionnelle (par des raisons et des justifications). Le monisme anomal défend donc la thèse selon laquelle, d’une part, un événement mental n’est autre qu’un événement physique, et, d’autre part, les concepts mentaux ne sont ni identiques, ni réductibles aux concepts physiques.
Là où H. Atlan se sépare de Davidson, à qui il reproche une lecture biaisée de Spinoza, c’est sur la question du libre-arbitre. Le refus, kantien, de rejeter le libre-arbitre conduit Davidson à défendre, contre Spinoza, la possibilité d’une causalité du mental sur le corporel. Il nous faudrait, au contraire, admettre que la liberté réside dans la connaissance des causes qui nous déterminent. Chez Spinoza, liberté et libre-arbitre ne sont pas synonymes. Ne serions- nous pas les acteurs de ce que nous faisons volontairement ?
Que devons–nous faire des qualia[10] ?
L’argument principal de ceux qui refusent la réduction du mental au cérébral réside dans le caractère irréductible de la conscience. Se pourrait-il que, malgré l’apparence, les expériences conscientes n’existent pas ?
Les propriétés qualitatives de nos états conscients, les qualia, semblent infirmer cette thèse puisqu’elles sont généralement décrites comme des propriétés ineffables, essentiellement subjectives. Si nos états mentaux sont dotés de qualia, alors la thèse d’après laquelle l’esprit humain serait entièrement identifiable à un ensemble de processus physiques est fausse. Mais les qualia existent-ils vraiment ? Daniel Dennett en doute fortement : pour lui, leur existence est un mythe philosophique dont l’origine serait à rechercher dans nos préjugés dualistes. Dès lors, pour le philosophe américain, la conscience n’est ni un lieu (par exemple, un théâtre), ni a fortiori un centre spé- cial du cerveau. Elle est plutôt une propriété résultant de processus locaux traitant des données sensorielles, en dépit du langage qui nous conduit à postuler l’existence de la conscience et à la considérer comme essentielle à l’esprit. L’expérience consciente n’est donc qu’une succession d’états constitués par des processus variés prenant place dans le cerveau. Elle ne se situe donc pas au-dessus de ces processus.
D’autres auteurs prétendent que la croyance aux qualia pro- viendrait des particularités de notre système introspectif : notre cerveau serait ainsi fait que lorsque nous portons notre attention sur nos états mentaux, nous y trouvons des qualités subjectives qui nous paraissent non physiques. Mais, en réalité, ces qualités n’existeraient pas et seraient le produit d’une illusion introspective[11]. L’idée sous- jacente est qu’une explication matérialiste de notre croyance en des propriétés phénoménales n’implique pas l’existence réelle de ces propriétés, comme une explication de la croyance en Dieu n’implique pas l’existence réelle de Dieu. Cette solution matérialiste du problème de la conscience s’accomplit néanmoins au prix de l’abandon de nos intuitions les plus profondément ancrées. L’idée que l’esprit ne serait qu’un rêve de la matière reste très minoritaire[12].
De ces débats, et de quelques autres, l’article de François Loth[13] rend parfaitement compte puisque son objet principal est de se demander si tout ce qui existe dans la nature, en particulier le phénomène de la conscience, peut être réduit au matérialisme physicaliste, celui-ci étant entendu, à la suite de Jaegwon Kim, comme la thèse selon laquelle « il n’y a rien à l’intérieur du monde dans l’espace-temps qui ne soit pas matériel, et bien sûr, il n’y a rien en dehors de lui, qui le soit ». La question est donc de savoir si l’on peut expliquer l’efficacité causale de certaines propriétés mentales (les propriétés phénoménales des expériences conscientes) dans un cadre physicaliste. F. Loth, sans nous contraindre à choisir, montre que cette question ne peut recevoir que trois réponses. Soit nous renouons avec le dualisme substantiel cartésien (mais alors le naturalisme ontologique serait faux), soit nous incluons les propriétés phénoménales dans ce naturalisme, soit, enfin, nous éliminons la conscience phénoménale de l’ontologie naturaliste.
Et le texte de Lucien Scubla vient se glisser dans ce débat. Tout en semblant se limiter à examiner comment le concept de nature a été transformé en fonction de l’évolution de la physique, son apport va bien au-delà : il considère que la mécanique quantique invalide les tentatives de naturaliser l’esprit et apporte de l’eau au moulin de ceux qui refusent la domination du physicalisme. Sa position se présente comme un dépassement de l’opposition mécanisme-finalisme. Il ne fait guère de doute qu’elle ne fera pas l’unanimité, tout particulièrement chez les physiciens. Nous en reparlerons dans notre prochain numéro.
De la différence anthropologique
Pour nous aider à saisir les enjeux de ces choix, la contribution de Joëlle Proust, une protagoniste majeure des rapports entre science et philosophie, est essentielle. Et, à la lire, on comprend que rationalisme et naturalisme ne peuvent aller l’un sans l’autre. Car que serait un rationaliste qui ne souhaiterait pas mettre l’explication philosophique en harmonie avec les données de l’expérience ? Dès lors, quel sort réserver au sens ? Conserver son rôle causal (réalistes du sens), l’éliminer (éliminativistes) ou, sans le conserver, considérer que l’attribution de désirs et de croyances à un agent permet de prédire ses comportements (interprétationnistes) ? Et ce n’est pas le choix d’une de ces ontologies qui définit le naturalisme, mais le souci d’intégrer les données scientifiques à l’étude conceptuelle. En outre, il convient de ne pas confondre, Jean-Michel Besnier y insiste, le réductionnisme ontologique et le réductionnisme épistémologique. Le premier n’est nullement exigé par le naturalisme alors que le second appartient constitutivement à la démarche scientifique. Il apparaît indissociable de l’idée même de progrès en science.
Comment alors pourrions-nous ne pas être naturaliste ? Joëlle Proust montre que le naturalisme ne menace nullement la philosophie. Son texte est, en outre, une précieuse synthèse des apports de la théorie de la métacognition (soit la capacité d’évaluer ses propres actions cognitives), en tant que domaine idéal-typique de rencontre entre science (la psychologie) et philosophie (et, tout particulière- ment, la question de l’unité et de la variabilité de l’esprit humain)[14].
Ce faisant, la contribution de Joëlle Proust constitue un apport à l’étude de la spécificité de l’humain, étude puissamment éclairée par l’article d’Anne Le Goff. Celui-ci reprend la thématique de son dernier ouvrage, L’Animal humain (Vrin, 2020), et la prolonge utilement. L’autrice part d’une difficulté substantielle : on ne peut, à propos de la différence anthropologique, mener conjointement l’objectif de notre commune naturalité avec les autres animaux et celui de notre radicale différence. Il convient par conséquent de considérer les traits de chaque espèce animale dans sa relation à son propre milieu. Cette perspective la conduit à faire sienne l’idée selon laquelle l’être humain est un animal particulier et non un animal spécial et donc à adopter une optique continuiste. Pourtant, les partisans du discontinuisme ont de sérieux arguments à faire valoir. Ils font de l’intentionnalité partagée[15], définie comme le produit de la capacité sophistiquée à comprendre les états mentaux des autres et, surtout, de notre désir d’échanger à leur sujet, le propre de l’humain. Mais, pour Anne Le Goff, il ne s’agit pas d’une différence fondamentale. Les études sur les chimpanzés montrent qu’ils apprennent les uns des autres à utiliser de nouveaux outils. Et, selon Frans de Waal, ils prennent part à des relations sociales codifiées qui impliquent une forme d’attention partagée. Il y aurait donc une continuité non seulement biologique mais encore cognitive et sociale entre les formes de vie animales et humaines. Cette approche n’implique cependant pas d’abandonner la différence, ouverte par les normes, qui existe entre les humains et les animaux. Le langage, nos institutions sont bel et bien uniques. Mais cette spécificité ne constitue pas une rupture au sein du vivant.
Si cette conclusion est fondée, rien ne s’oppose à ce que le champ de l’éthique soit étudié avec les procédures des sciences naturelles. Vanessa Nurock s’était déjà demandé, en 2011, dans Sommes- nous naturellement moraux ?, si l’espèce humaine était prédisposée à développer une capacité au jugement moral. Dans le présent texte, qui, entre autres mérites, éclaire le rôle pionnier de Jean Piaget dans la tentative de naturalisation de l’éthique, elle dégage la fécondité de l’héritage quinien (mis également en évidence, par d’autres voies, par Joëlle Proust), quoi que l’on puisse penser des conceptions épistémologiques de Quine. D’ailleurs, la naturalisation de la morale, telle qu’elle est développée par les sciences cognitives, rompt fondamentalement avec l’approche de Quine, ce dernier manifestant une forte réserve quant à la possibilité de traiter les jugements moraux (selon lui, nécessairement subjectifs) comme les jugements scientifiques. Il y a cependant un authentique profit à tirer des travaux cognitivistes. En particulier, celui de dégager les capacités universelles inscrites dans notre héritage génétique.
V. Nurock pose, en outre, l’existence d’une certaine continuité entre la naturalisation de la morale et son artificialisation. Cette dernière se heurte à un écueil similaire à ce qu’il convient de nom- mer le sophisme naturaliste[16] et qu’elle appelle le sophisme artificialiste, lequel réduit la morale à des « faits » artificiels. Cette réduction du normatif au descriptif, une forme extrême de positivisme, doit être rejetée. Ce rejet ne signifie pas qu’il faille se détourner de l’attention portée à la métaéthique (c’est-à-dire à l’étude des questions philosophiques qui portent sur la morale sans être elles-mêmes des questions morales). Il est fondamental de savoir si, comme le pensait Quine, les faits moraux décrivent des faits subjectifs ou si l’on peut, au contraire, défendre un réalisme naturaliste, lequel suppose qu’il n’y ait pas de divergence ontologique fondamentale entre le monde de la science et celui de la morale.
Un agenda pour le rationalisme
Le texte de Pascal Engel éclaire nombre d’enjeux de ce dossier. C’est pourquoi nous avons souhaité qu’il figure en conclusion. L’œuvre du philosophe représente, pour le rationalisme, une référence majeure. Son dernier ouvrage, Manuel rationaliste de survie, défend quatre fortes thèses : la raison est une faculté de l’esprit, les normes morales et cognitives sont constitutives de la raison, ces normes sont connaissables a priori et, enfin, elles impliquent des raisons objectives et valides pour nos actions et nos croyances. La question que pose P. Engel dans sa contribution est de savoir comment ces normes de la raison, principalement leur objectivité, peuvent être compatibles avec le naturalisme. Autrement dit, des normes objectives pourraient-elles être également naturelles ? En répondant positivement à cette question, le philosophe défend une forme de rationalisme naturaliste dont il nous faut souligner le caractère attractif. Cet objectif implique une discussion critique des conceptions rivales.
En premier lieu, la théorie de l’erreur pour laquelle la morale est une illusion : le jugement moral relève du désir ou des préférences et, dès lors, les critères du vrai et du faux ne sont pas applicables. John Mackie, le plus célèbre représentant de ce courant, défend ainsi l’idée que le langage moral est illusoire ou trompeur. À l’instar des énoncés qui contiennent des prédicats magiques ou astrologiques, les énoncés moraux sont tous faux. Ensuite, l’expressivisme pour lequel les énoncés moraux n’ont pas la prétention de représenter le monde : leur signification dépend des attitudes qu’ils expriment. Ce qui importe est l’effet produit sur l’interlocuteur.
Pour P. Engel et, notamment, le réalisme de Cornell, les jugements moraux représentent des faits objectifs et ces faits sont naturels (on considérera comme naturelle une entité qui peut constituer l’objet d’étude d’une science empirique). Les vérités morales sont indépendantes des agents qui les reconnaissent. Dans cette perspective, on rendra compte de l’existence de faits moraux par le concept de survenance[17] (auquel F. Loth fait allusion en notant qu’il n’est guère différent de celui d’émergence). Cette précision est essentielle : si P. Engel concède que le naturalisme quant aux normes morales n’est pas démontré, il est néanmoins vrai en un sens très général « qui tient à la fondation des propriétés éthiques sur des propriétés naturelles et à leur survenance ». Mais la survenance ne possède aucun pouvoir explicatif, si bien que le mariage entre réalisme normatif et naturalisme risque de n’être pas consommé : l’empire des normes ne se réduit pas à celui de la nature. Les raisons et les causes, bien qu’elles se réfèrent au même événement cognitif, ne constituent pas des propriétés identiques. Naturaliser n’équivaut donc pas à souscrire au réductionnisme éliminatif[18].
Il arrive que la joie soit le terme de l’effort. Nous souhaitons que la lecture de ce dossier permette au lecteur de l’éprouver, à l’ins- tar de Spinoza qui la liait aux progrès dans la recherche de la vérité. Car quel autre horizon assigner à l’enquête philosophique comme l’illustre exemplairement l’œuvre de Jacques Bouveresse à laquelle Pascal Ludwig rend un magnifique hommage ?
* Chercheur associé au Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof). Dernier livre paru : Le Monde selon Francis Wolff . Ontologie, éthique et anthropologie, Classiques Garnier, septembre 2021.
1 Ce dossier, dirigé par Jean-Michel Besnier et Alain Policar, a bénéficié des conseils de Jacques Hoarau.
2 Dennett, D. (1991), La Conscience expliquée, trad. fr. par Pascal Engel, Paris, Odile Jacob, 1993, p. 11.
3 Doctrine selon laquelle les causes naturelles ne sont pas de véritables causes, mais seulement des « causes occasionnelles » qui déterminent Dieu, seule vraie cause, à agir.
4 Cité par Pascale Gillot dans son remarquable ouvrage, L’Esprit, figures classiques et contemporaines (2007), CNRS éditions, p. 25.
5 Ibid. C’est la fameuse glande pinéale : Descartes avait identifié dans l’hy- pophyse un organe cérébral qui n’avait pas son symétrique et qui, au titre de cette singularité, pouvait se voir attribuer cette fonction étonnante d’incorporer (d’incarner) l’âme. Cette erreur a contribué à occulter la radicale modernité de la pensée cartésienne.
6 Ibid., p. 32.
7 Lettre de Descartes à Elisabeth du 28 juin 1643, Adam et Tannery III, p. 692.
8 Descartes, Méditations philosophiques, Méditation sixième, Adam et Tannery, IX, p. 64.
9 Par action réciproque, il faut entendre interaction psychophysique : il existerait une inscription corporelle de l’âme par laquelle celle-ci peut mouvoir le corps et en retour éprouver des sentiments et passions dont le corps constitue la cause.
10 Les qualia sont les qualités spécifiques ressenties lors de chaque épisode mental, qui déterminent l’effet que cela fait pour le sujet d’être dans ces états.
11 Cette thèse audacieuse semble progresser. Elle est défendue par, outre Dennett (From Bacteria to Bach and Back, Norton & Company, 2017), Derek Pereboom, Consciousness and the Prospects of Physicalism, Oxford University Press, 2011, et Keith Frankish, « Illusionism as a Theory of Consciousness », Journal of Consciousness Studies, 2016, 23(11-12): 11-39.
12 On trouvera, en langue française, une présentation détaillée de l’illusion- nisme dans l’ouvrage récent de François Kammerer, Conscience et matière . Une solution matérialiste au problème de l’expérience consciente, Matériologiques, 2019.
13 L’auteur avait, en 2013, publié une remarquable synthèse, à laquelle les lecteurs de ce dossier pourront se reporter : Le Corps et l’esprit . Essai sur la causalité mentale, Vrin, 2013.
14 Voir notamment Philosophy of Metacognition: Mental Agency and Self- Awareness, Oxford University Press, 2013.
15 Voir les travaux de Michael Tomasello et, notamment, Origins of Human Cognition, MIT Press, 2008.
16 Selon l’expression de G. E. Moore pour désigner la réduction des normes aux faits. Erreur de raisonnement dénoncée par Hume et l’empirisme.
17 Notion introduite en philosophie de l’esprit par Donald Davidson en 1980 dans Essays on Actions and Events.
18 Voir Joëlle Proust, « Redéfinir l’humain. Pour une convergence des sciences de l’homme », Le Débat, mai-août 2014, 180: 56-69.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Actualité de Jacques Bouveresse
Pascal Ludwig*
La place de Jacques Bouveresse dans la philosophie contemporaine restera aussi importante que singulière. Par ses publications originales, prolifiques, diverses – Bouveresse était aussi brillant lorsqu’il exposait les idées du logicien Kurt Gödel que lorsqu’il commentait son romancier de chevet, Musil –, tout autant que par son enseignement dans les universités de Paris, de Genève, puis au Collège de France, il aura joué un rôle unique et crucial dans notre paysage intellectuel, notamment pour tous les philosophes qui se réclament de la tradition analytique. Grand lecteur de Wittgenstein, mais aussi d’autres auteurs de langue allemande comme Leibniz, Lichtenberg, Kraus, Boltzmann ou Musil, Bouveresse était pour- tant paradoxalement perçu en France comme un représentant de la
« philosophie analytique anglo-saxonne ». Au moment d’évoquer sa mémoire, et la source d’inspiration qu’il fut pour tant d’entre nous, je voudrais revenir sur quelques aspects de sa pensée, laquelle me frappe par son actualité.
La vérité pour norme et pour horizon
Bouveresse considère que les vérités sont objectives, absolues plutôt que construites, et que la vérité constitue une norme pour l’enquête philosophique tout autant que pour l’enquête scientifique :
« une des composantes essentielles de ce qu’on est convenu d’appeler la «rationalité occidentale» », écrit-il, « est (…) effectivement la recherche de la vérité comme norme, qui entraîne l’obligation de produire des hypothèses et des théories susceptibles de se heurter quel- que part à une “réalité” »[1]. Cela fait de lui un jalon important dans la tradition rationaliste française, qui va de Couturat à Vuillemin[2]. Contre l’idée foucaldienne d’une « invention », d’une « histoire » de la vérité, qui pourrait n’être qu’un « épisode », Bouveresse maintient que si nos attitudes vis-à-vis des vérités peuvent changer, cela n’implique pas que les propositions vraies, qui décrivent des faits, soient relatives à quoi que ce soit[3]. Il se différencie également de ses aînés Martial Guéroult et Jules Vuillemin par la conviction selon laquelle le concept de vérité est univoque. Certes, Bouveresse reconnaît, à la suite de ses maîtres, que le consensus est inexistant en philosophie, et que la démarche philosophique s’écarte, en cela, de la démarche scientifique. Les positions philosophiques ne « s’imposent jamais (…) comme les seules possibles », ce qui conduit à la cohabitation d’une « pluralité de réponses différentes qui semblent également possibles et dont chacune réussit à trouver, dans la communauté philosophique, un nombre plus ou moins important de défenseurs »[4]. Selon Bouveresse, l’explication de cette pluralité réside néanmoins dans la nature des méthodes de justification qu’utilisent les philosophes, et non dans l’existence d’une espèce philosophique de la vérité[5]. Citant Marcel Proust[6], il affirme d’ailleurs qu’il n’y a pas plus de vérité « littéraire » qu’il n’y a de vérité « philosophique » ou « scientifique ». Le problème qui se pose réellement à propos des vérités philosophiques ou littéraires, ce n’est pas de savoir quelle serait leur spécificité – elles n’ont rien de spécifique, puisque le concept de vérité est univoque – mais de savoir comment elles peuvent être connues. Une proposition philosophique vise à décrire un fait, mais un fait qui ne peut généralement pas être vérifié expérimentalement. Comment réconcilier alors l’objectivisme de la vérité, qui nous pousse à reconnaître l’existence de vérités philosophiques, avec le constat qu’il n’existe, semble-t-il, aucune méthode propre à la philosophie permettant d’atteindre un consensus dans ce domaine ?
La philosophie comme thérapie
Une première réponse possible, celle du philosophe britannique T. Williamson notamment, consiste à exhorter les philosophes à tenter de « mieux faire » : le fait que les thèses consensuelles soient si rares n’implique pas qu’il soit impossible, en principe, de converger vers un accord. Pour cela, il faut utiliser au mieux tous les outils les plus efficaces à notre disposition, y compris les outils et les don- nées issus de la recherche scientifique[7]. La position de Bouveresse est très différente. S’inspirant de Wittgenstein, mais aussi de la tradition austro-britannique de F. Waismann, G. Ryle, et surtout J. L. Austin, il suggère qu’un bon philosophe est avant tout un bon thérapeute, c’est-à-dire un professionnel capable d’identifier les problèmes philosophiques et de les traiter. Ces problèmes reposent sur des illusions[8], dont la tâche de la philosophie, lorsqu’elle est correctement exercée, est de nous guérir. En 1973, dans son premier article consacré à Wittgenstein, « Wittgenstein et la philosophie »[9], Bouveresse présente pour la première fois, de façon magistrale, la conception wittgensteinienne de la philosophie : les problèmes philosophiques peuvent être dissipés, mais cela n’implique ni qu’il y ait des opinions philosophiques dont la vérité pourrait être prouvée, ni qu’il puisse exister une « communauté de doctrine » ou un consensus en philosophie. La philosophie bien comprise effectue en effet plutôt un travail de sape qu’un travail de justification rationnelle de thèses positives. Dans le Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein considérait qu’aucune proposition ne peut être connue a priori en tant que vérité nécessaire. Connaître une proposition revient en effet à pou- voir exclure tous les cas dans lesquels elle est fausse. Or, une pro- position nécessaire ne peut exclure aucun cas, puisqu’elle doit être vraie dans tous les cas possibles. C’est la raison pour laquelle il n’y a de théorèmes, selon Wittgenstein, ni en logique, ni en mathématiques : ces disciplines ne peuvent littéralement rien prouver, puisque si c’était le cas il y aurait des propositions nécessaires, ce qui n’a pas de sens. Pour des raisons semblables, la philosophie ne devrait pas avoir pour but de produire des théories dont on pourrait formuler et justifier le contenu propositionnel. On ne comprend le style philosophique unique de Jacques Bouveresse qu’à partir du moment où l’on voit qu’il reprend pour l’essentiel à son compte cette conception wittgensteinienne de la philosophie[10].
Dissoudre les problèmes, dégonfler les baudruches
Si, en suivant Wittgenstein, on pense que « la philosophie se contente de placer toute chose devant nous, sans rien expliquer ni déduire »[11], il existe un espace pour une méthode qui n’est pas, ou pas seulement, argumentative. Dans la plupart de ses travaux, Bouveresse s’appuie sur les textes qu’il commente, souvent de façon érudite et minutieuse, pour rendre manifeste certains problèmes philosophiques bien plus que pour établir des thèses. Il ne se considérait d’ailleurs pas comme un historien de la philosophie, et ne dissociait jamais l’analyse des textes du souci de la vérité, ni de la volonté d’apporter un éclairage nouveau sur un problème philosophique en montrant, par une lecture ou par des rapprochements audacieux entre les textes, les limites de certaines théories, souvent liées à une utilisation illusoire de la grammaire.
Dans Le mythe de l’intériorité, Bouveresse suggère ainsi que les philosophes cartésiens, trompés par la grammaire des concepts psychologiques, confondent certaines contraintes liées à l’utilisation de ces concepts avec des propriétés métaphysiques essentielles. Considérons la subjectivité d’une douleur. C’est une propriété qui peut sembler essentielle à cette expérience consciente, car il est difficilement concevable qu’une expérience de douleur puisse nous être présentée comme la douleur d’une autre personne. Avons-nous découvert ici, par l’approche introspective propre à la méthode cartésienne, une essence inaccessible à l’enquête scientifique en troisième personne ? Si nous sommes tentés de le croire, selon Bouveresse, c’est parce que nous confondons la force contraignante d’une règle grammaticale, qui relie la perception d’une douleur à l’énoncé « j’ai mal », avec une nécessité métaphysique. Bouveresse dénonçait de façon inlassable la tendance philosophique à projeter dans un arrière-monde les pseudo-entités que nous postulons pour tenter de donner un contenu cognitif aux règles grammaticales.
Ce patient travail de sape des ambitions métaphysiques illusoires était solidaire d’une forme particulièrement solide de réalisme[12]. Cela explique qu’il ait été un précurseur, en France, du réalisme naïf en philosophie de la perception[13] : les propriétés sensibles, comme les couleurs ou les sons, n’existent pas, selon lui, dans un arrière-monde cartésien mais précisément là où notre langage courant localise les apparences, c’est-à-dire dans les objets qui nous entourent. Cela l’a aussi amené à s’intéresser très tôt[14] à la question, abordée par Wittgenstein dans De la certitude, du statut épistémique des énoncés décrivant des vérités évidentes, tel l’énoncé célèbre de Moore « j’ai deux mains ». Cet énoncé est problématique, car quoiqu’il soit contingent et a posteriori, on ne voit pas bien comment on pourrait le justifier à l’aide d’arguments, puisque les prémisses de ces arguments devraient manifestement avoir un degré moins élevé de certitude que leur conclusion. Dans cette perspective, la prise en considération de la grammaire du jeu de langage de la justification rationnelle, qui révèle que de telles justifications ont toujours un caractère local et non global, peut nous aider à dissiper le rêve d’une fondation ultime de la connaissance : « La difficulté, souligne Wittgenstein, c’est de nous rendre compte du manque de fondement de nos croyances »[15]. Certes, remonter de raison en raison dans le jeu de langage de la justification rationnelle conduit toujours à un terminus, mais ce point d’arrêt se situe « au-delà de l’opposition justifié/non-justifié », il a quelque chose « d’animal »[16]. Dès la rédaction du Mythe de l’intériorité, Bouveresse souligne avec lucidité que cette conception de la justification rationnelle comme jeu de langage local (plutôt que global) permet de saper le scepticisme cartésien[17].
Bouveresse était sceptique devant l’idée d’un fondement philosophique ultime de la connaissance. Il était aussi particulièrement méfiant vis-à-vis des théories philosophiques grandioses qui fleurirent en France dans le courant des années 1960, mais qui avaient selon lui fort peu de prise sur le monde réel. Il n’hésitait pas à manier l’ironie pour dégonfler certaines baudruches philosophiques[18]. Dans son brillant opuscule Prodiges et vertiges de l’analogie, il décrit avec brio comment l’austère théorème de Gödel a pu être fantasmé, par un glissement partant d’images imprécises et aboutissant à des analogies incontrôlées, comme impliquant que « l’engendrement d’un individu par lui-même serait une opération biologiquement contradictoire », ou « qu’il est rationnel qu’il y ait de l’irrationnel dans les groupes »[19]. Dans ses écrits polémiques aussi, Bouveresse s’attache ainsi avant tout à nous guérir d’une certaine manière pathologique d’envisager la philosophie.
Bouveresse politique
La sensibilité de Jacques Bouveresse aux présupposés de l’enquête et de l’activité philosophiques, à leurs points aveugles comme à leurs conditions réelles, explique probablement qu’il ait accepté de rédiger en 1989 un rapport sur l’enseignement de la philosophie avec Jacques Derrida[20]. Chose assez unique pour un texte de cette sorte, ce rapport n’a pas pris la moindre ride : lorsqu’on le relit aujourd’hui, on est frappé par la lucidité des auteurs, et aussi un peu désespéré que ses principales recommandations n’aient jamais été mises en œuvre. Ce rapport fut globalement mal reçu par la profession, peut-être parce qu’il partait d’une vision modeste et réaliste de l’enseignement philosophique, aux antipodes de l’idéologie en vigueur[21]. Il se plaçait du point de vue des élèves et prêtait une grande attention aux injustices scolaires. Pour Jacques Bouveresse, le véritable pouvoir de subversion de la philosophie se mesurait très exactement à sa capacité à transformer la réalité sociale, et non à simplement rêver une telle transformation. Ici aussi, il nous reste énormément à apprendre de ses travaux.
_____________________________________________
* Maître de conférences à Sorbonne Université
1 Bouveresse, J. (1976), « Essentialisme, réduction, et explication ultime » Revue internationale de philosophie, 117-118: 411-434.
2 Tiercelin, C. (2012), Bouveresse dans le rationalisme français, Agone, Marseille, p. 11-34.
3 Voir Bouveresse (2016).
4 Bouveresse, J. (2012), Qu’est-ce qu’un système philosophique ?, Cours au Collège de France 2007 & 2008, Collège de France, Paris, cours 6.
5 Ibid., cours 11.
6 Bouveresse, J. (2008), La Connaissance de l’écrivain . Sur la littérature, la vérité et la vie, Agone, Marseille, p. 16.
7 Timothy Williamson considère qu’il existe au fond bien plus de proximité qu’on ne le croit en général entre la méthode philosophique et la méthode scientifique. Williamson, T. (2007), The Philosophy of Philosophy, Blackwell Publishing, Malden, Mass., Oxford.
8 L’expression anglaise plus forte de « delusion » serait plus appropriée. Voir sur ce point Fischer, E. (2011), Philosophical Delusion and its Therapy, Routledge, New York.
9 Bouveresse, J. (1973), « Wittgenstein et la philosophie », Bulletin de la Société Française de Philosophie, 68: 90-122. Repris dans Bouveresse, J. (2003), Wittgenstein et les sortilèges du langage, Agone, Marseille, sous le titre « Les problèmes philosophiques et le problème de la philosophie ».
10 Voir sur ce point Rosat, J.-J. (2012), « Les armes de Wittgenstein », Agone, Marseille, 48: 141-162.
11 Wittgenstein, L. (2014), Recherches philosophiques, Gallimard, Paris.
12 Bouveresse décrit le réalisme comme « une chose qui a une signification personnelle très profonde », et il ajoute que « l’essentiel du combat que j’es- saie de mener aujourd’hui est un combat contre l’idéalisme », Bouveresse, J. (1998), Le Philosophe et le réel . Entretiens avec Jean-Jacques Rosat, Hachette, Paris, p. 36.
13 Bouveresse, J. (1995), Langage, perception et réalité . Tome 1 : la percep- tion et le jugement, Jacqueline Chambon, Nîmes.
14 Bouveresse, J. (1976), Le Mythe de l’intériorité, Éd. Minuit, Paris. 15 Wittgenstein, L.( 1976), De la certitude, Gallimard, Paris, p. 166. 16 Ibid., p. 359.
17 Pour un développement récent de cette intuition, voir Pritchard, D. (2016), Epistemic Angs: Radical Skepticism and the Groundlessness of our Believing, Princeton University Press, Princeton.
18 Il est frappant qu’il ait retourné l’ironie post-moderne contre elle-même, par exemple dans Bouveresse, J. (1984), Rationalité et cynisme, Éd. Minuit, Paris.
19 Bouveresse, J. (1999), Prodiges et vertiges de l’analogie, Raisons d’agir, Paris, p. 27.
20 Rapport de la Commission philosophie et épistémologie, repris dans Derrida, J. (1990), Du droit à la philosophie, Galilée, Paris, p. 619-659.
21 « Le propre d’une idéologie de profession, souligne Bouveresse, c’est de fournir une vision anoblie, idéalisée, de cette profession (…). Les philoso- phes, c’est la même chose, mais à la puissance deux, étant donné que ce sont justement des professionnels de l’idéalisation » (Bouveresse, J. (2003a), Bourdieu, savant et politique, Agone, Marseille, p. 61.