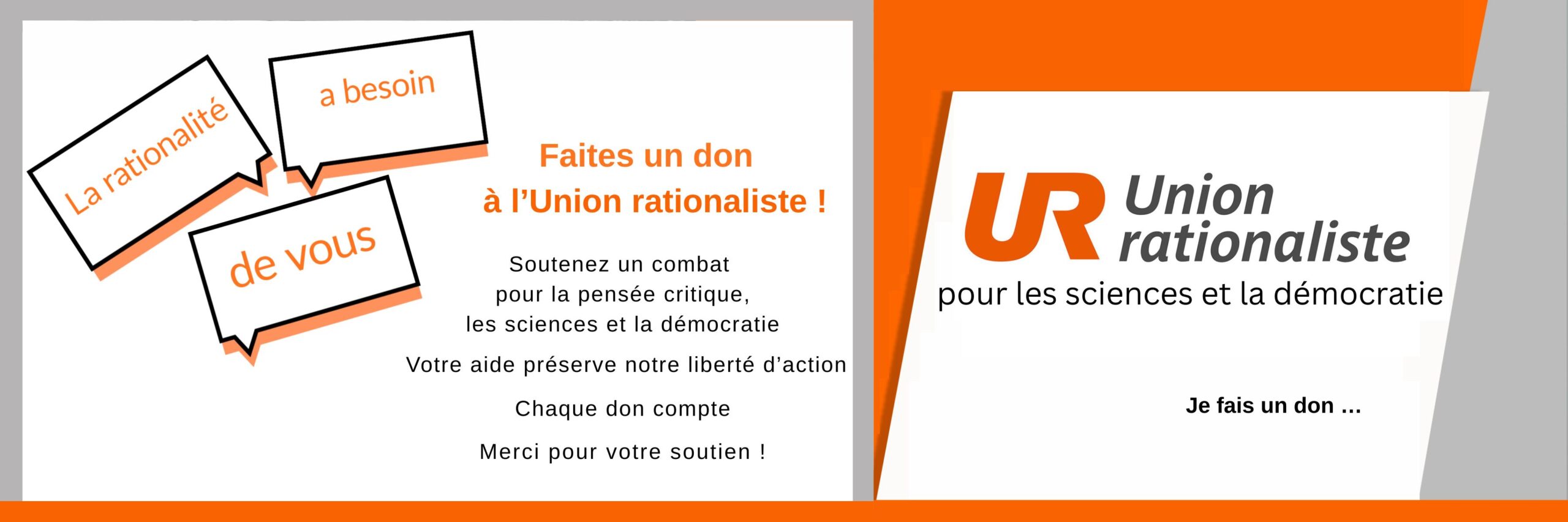





L'édito de l'Union
Crise climatique et crise démocratique - Le déni des faits
18/11/2025
La COP30 de l’ONU sur le changement climatique s’ouvre à Belém au Brésil. Les enjeux de cette grand-messe sont nombreux, mais l’ambition ne semble pas au rendez-vous. L’argent sera-t-il au niveau adéquat pour compenser les désastres du réchauffement dans les pays les plus pauvres, tels ceux d’Afrique ou d’Océanie, qui paient le prix le plus élevé pour le CO2 émis sans modération par les pays les plus riches ? On peut en douter, d’autant plus que Donald Trump a choisi de ne pas faire participer son pays à la COP, justifiant ce retrait par des arguments d’une grande perversité qui s’apparentent au déni des faits.
Les leviers mis en œuvre aux États–Unis pour faire reculer l’action climatique sont nombreux. Ils relèvent d’une stratégie à la fois économique et idéologique, allant du retrait des engagements internationaux à l’abrogation massive des normes de régulation, sans omettre le retrait de financements pour la justice climatique et la transition, le tout accompagné de tentatives de “policer” le langage des agences américaines (des mots comme “pollution”, “réchauffement”, “réchauffement global” ou “énergies propres” ont été bannis) afin de minimiser la notion de menace. L’administration remet en question la “science dominante” en la qualifiant parfois de “groupéisme”, “alarmisme”. Le rapport du DOE (Department of Energy) affirme que le consensus scientifique est biaisé, politisé, que la communauté scientifique dominante ignore les incertitudes ; il utilise des données contestées par les climatologues sur la banquise, les incendies, etc. Bref, nous assistons à un dévoiement massif des bonnes pratiques scientifiques pour les retourner contre la science, tout comme la liberté de parole est retournée contre la démocratie.
En France aussi l’action des pouvoirs publics sur le climat est en recul, malgré des déclarations volontaristes pour atteindre les objectifs de la COP de Paris. Et le climato-scepticisme règne : 10 % de nos concitoyens ne croient pas au changement climatique, 23 % le pensent possible mais nient son origine anthropocène. Et ceci malgré l’évidence des faits démontrés scientifiquement par les travaux du GIEC, par l’accélération des catastrophes naturelles et par les températures records enregistrées ces trois dernières années. On préfère ne pas croire ce que pourtant l’on sait !
Pourquoi le changement climatique est-il un terrain si fertile pour la désinformation ? La science du climat est intrinsèquement abstraite, complexe, une perturbation dont les effets graves à moyen et long terme ne sont pas immédiatement tangibles. Aux États-Unis, la politique climatique est souvent présentée par les médias de droite comme une ingérence de l’élite contre le peuple. En France, le discours anti-écologique tourne généralement autour des thèmes du contrôle, des taxes et de la punition, mal perçus en particulier par les couches sociales les plus défavorisées. Les réactions des citoyens répondent à un sentiment d’identité et d’injustice. Au temps de l’IA, les réseaux sociaux permettent à n’importe quel récit de circuler largement sans contrepoids. Des acteurs opportunistes profitent de cet environnement de défiance pour semer le scepticisme et diffuser de fausses informations, s’inspirant et prenant la suite des opérations commanditées avec succès par des producteurs d’énergie fossile hors de tout respect de l’avenir de leurs enfants. Ils maîtrisent l’art d’imiter l’« expertise » ou de la discréditer, et font largement jouer en ligne des bots destinés à fabriquer un faux consensus qui n’est pas celui des scientifiques. La désinformation climatique est devenue une arme utilisée par divers acteurs pour faire avancer leurs objectifs stratégiques et retarder la transition mondiale nécessaire et urgente vers les énergies propres.
La diffusion délibérée de fausses informations sur le climat a réussi à saboter la perception qu’a le public de la réalité de cette menace, affaiblissant notre capacité à réagir. Les forces qui agissent derrière le déni climatique participent ainsi à saper les fondements de la démocratie. Les faits fondamentaux sur lesquels reposent notre monde et nos existences ne sont plus acquis. Ils sont même désormais vivement contestés. La désinformation est devenue une attaque systématique contre les institutions et les normes-mêmes qui sous-tendent la possibilité de « faire société ». Cette érosion d’une base commune de vérité est à l’origine de l’impasse démocratique qui percute brutalement la crise climatique. Et l’on sait que les politiques de « post-vérité », manipulées par l’extrême droite, favorisent dangereusement l’essor de l’autoritarisme.
Pour relever le défi, il faudra non seulement des politiques climatiques robustes appuyées sur un effort international, mais aussi une prise de conscience collective des manipulations de l’information par la tromperie délibérée. Comme nous en a avertis Hannah Arendt :
« Le résultat d’une substitution cohérente et totale de mensonges à la vérité de fait n’est pas que les mensonges seront maintenant acceptés comme vérité, ni que la vérité sera diffamée comme mensonge, mais que le sens par lequel nous nous orientons dans le monde réel se trouve détruit. »
Michèle Leduc et François Bouchet, avec le bureau de l’UR
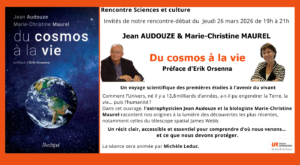
Rencontre Sciences et culture #22
Jeudi 26 mars 2026 – Invités de notre conférence débat, Jean AUDOUZE & Marie-Christine MAUREL pour présenter leur ouvrage : Du cosmos à la vie”
– L’Union rationaliste aura l’honneur d’accueillir Jean AUDOUZE, Astrophysicien,

Annulation d’un colloque au Collège de France – Déroute de la liberté de penser et de débattre
L’Union rationaliste tient à manifester son indignation devant l’annulation d’un grand colloque international sur « La Palestine et l’Europe » qui devait se tenir les 13 et 14 novembre prochains au Collège de

Loi « Duplomb » Déni de la science, honte pour la démocratie
L’Union rationaliste tient à manifester son complet désaccord avec la loi « Duplomb », si ouvertement contraire au « bien commun ». Cette loi visant à encadrer les procédures de l’agriculture intensive a
Articles les plus lus
Ce que la crise des PFAS nous apprend
Robert Barouki, université Paris Cité, Inserm, Paris, France > Les per- et polyfluoroalkyles (PFAS) sont des substances très utilisées dans l’industrie et sont présents dans de nombreux articles de la vie courante. L’ARS Rhône-Alpes a bien résumé leurs propriétés et leurs multiples applications . Il existe des milliers de PFAS, même si pour le moment une trentaine est très utilisée. Leurs propriétés chimiques sont uniques avec une extrémité hydrophile et une chaîne carbonée plus ou moins longue aux propriétés hydrophobes. La structure des 12 000 PFAS est ainsi constituée d’une chaîne carbonée d’au moins 2 carbones avec des groupes fonctionnels (carboxylates : PFCA ; sulfonates : PFSA) leur conférant à la fois des propriétés hydrophobes et hydrophiles (Lu et coll, 2020 ; Langenbach et coll, 2021 ; Cordner et coll, 2021 ; Blake et coll, 2020). Les acides perfluoroalkyles (PFAA) linéaires « anciens » comprennent des composés utilisés de longue date (p. ex. acide perfluorooctane sulfonique, PFOS et acide perfluorooctanoïque, PFOA), tandis que les PFAS émergents font référence aux PFAA courts ou ultra-courts (avec 4-7 ou 2-3 carbones), ramifiés ou non, ainsi que des isomères dans le but de produire des alternatives plus sûres …
Incendies sauvages, mégafeux et réchauffement climatique
Marie-Antoinette Mélières, physicienne et paléoclimatologue > Bien des aspects de la planète Terre sont perturbés depuis quelques décennies par le réchauffement climatique en cours. Qu’en est-il des incendies ? D’origines diverses, ils sont le résultat de l’action de l’homme lors de la déforestation et d’incendies de savane, mais peuvent aussi se développer spontanément, formant des feux sauvages qui s’étendent sur des centaines de kilomètres et détruisent la vie et les écosystèmes existants. Ces feux extrêmes sont un phénomène récent. En parcourant quelques exemples, nous montrons ici comment la recherche se développe pour les caractériser, comprendre comment ils sont générés et prouver qu’ils progressent à mesure que le climat se détériore…
Pression de la pollution anthropique chimique sur la planète
Une structure internationale pour informer et agir > Les pressions sur la planète, résultant des activités humaines, se sont considérablement amplifiées depuis le XIXe siècle, avec une accélération depuis les années 1940. Les conséquences sont impressionnantes dans leurs aspects positifs mais également négatifs. Positifs car, dans les pays les plus riches, l’espérance de vie des humains et leur espérance de vie en bonne santé n’ont cessé d’augmenter, et les systèmes de vie (habitats, transports, loisirs, travail…) se sont considérablement améliorés. La recherche et l’innovation ont généré des éléments extraordinairement importants (informatique, communications, transports, santé, énergie, production alimentaire…). Négatifs, car ces évolutions ne se sont pas accompagnées par une véritable prise en compte de leurs impacts planétaires et humains à long terme. En effet, la contrepartie de ces progrès se traduit notamment par une augmentation des inégalités, une dégradation sévère de l’état de l’environnement, le changement climatique et ses conséquences désastreuses, un bouleversement de l’occupation des sols, une démographie considérable, une diminution de la biodiversité…
Roger Martin du Gard et le rationalisme
Roger Martin du Gard fut un écrivain très apprécié, prix Nobel de littérature, aujourd’hui quelque peu oublié, il est encore lu cependant. On sait qu’il se déclara athée, et il le resta jusqu’à la mort, même si la question de Dieu ou de la religion l’a préoccupé tout au long de sa vie. Nous disposons maintenant de son Journal, de sa correspondance générale, de sa correspondance avec Copeau, Gide, Dabit… Surtout son roman inachevé Maumort a été publié (la version intégrale en Pléiade), il est donc possible actuellement de cerner au mieux la pensée de Roger Martin du Gard.
Ce fut un matérialiste, lecteur de Renan, Taine, Le Dantec et aussi de Montaigne, mais il se déclara toujours comme un piètre penseur, ce qui peut surprendre de la part d’un écrivain qui, dans ses romans, a semblé défendre des thèses. De formation, il est chartiste, passionné par la documentation, aimant la précision : son style, fluide et charpenté s’adapte à ce goût pour l’objectivité et, dans son Journal, a priori écrit intime, on retrouve ce besoin de clarté, comme s’il écrivait pour un lecteur qui n’est autre que lui-même.
Roger Martin du Gard prétend ne pas comprendre les philosophes et d’ailleurs il avoue, dans son Journal, éviter les relations intellectuelles, prétendant se sentir inférieur aux grands penseurs qu’il a l’occasion de croiser. Son athéisme ne serait pas la conséquence d’une réflexion mais plutôt comme un atavisme ne dépendant pas de lui.
Qu’en est-il vraiment ? Faut-il croire l’auteur ou supposer qu’il serait plus philosophe qu’il voudrait bien l’avouer, mais cachant ses spéculations par pudeur ? Martin du Gard a le goût du secret, toutefois il consent à se livrer dans son Journal intime mais il est difficile de conclure…
Climato-scepticisme et variations de la température de la Terre dans le passé
> DOCUMENT <
Par ignorance ou par mauvaise foi, les « climato-sceptiques » rejettent l’urgence d’une transition écologique. Ils sont encore nombreux, notamment aux États-Unis, et parfois très influents par les pressions qu’ils exercent sur des responsables politiques. Parmi eux, il faut distinguer (i) ceux qui nient que le réchauffement actuel soit sans précédent, (ii) ceux qui admettent que le réchauffement actuel n’a pas d’équivalent dans le passé mais qui nient son origine anthropique, et (iii) ceux qui admettent l’origine anthropique du réchauffement actuel mais nient la gravité de ce dernier.
Plutôt que d’une analyse scientifique, certaines de ces prises de position résultent d’un a priori idéologique ou d’intérêts personnels (c’est le cas le plus fréquent) – mais on se doit d’y répondre …
Débat sur la géo-ingénierie
> DOCUMENT <
Deux grandes familles de projets de géo-ingénierie : les émissions négatives de CO2 et l’amoindrissement de l’effet de serre.
Les accords de Paris ont pour objectif de limiter l’augmentation de
température moyenne de l’atmosphère due au réchauffement climatique sous le seuil de 2°C de plus que sa valeur préindustrielle (moyenne entre 1850 et 1900). Depuis 2018, le rapport spécial du GIEC commandé par les
« petits pays » a abaissé ce seuil à 1,5°C, démontrant qu’un réchauffement de 2°C mettrait particulièrement en danger les zones intertropicales et polaires. Dans les deux cas, mais encore plus dans le second puisqu’il s’agit d’une réduction plus drastique, remplir les objectifs fixés impose des « émissions négatives » c’est-à-dire de piéger (ou d’éliminer) du CO2 de l’atmosphère …
La question de l’eau dans le monde : faut-il s’angoisser ?
> DOCUMENT <
Il y a deux fois plus d’eau superficielle et souterraine que de terres émergées sur la planète qui porte donc un nom usurpé. Une quantité infime est disponible pour les usages dont l’accroissement est encore plus rapide que celui de la démographie. Le stress hydrique (quotient entre des ressources économiquement disponibles et le nombre d’habitants) est facteur d’angoisse …
Les terres rares et la transition écologique
> DOCUMENT <
Comment s’engager dans la transition écologique ? Le débat est ouvert et, malheureusement, au vu de la complexité du sujet, les arguments avancés manquent souvent de rigueur. Le problème sera abordé sous l’angle des terres rares, qui semblent indispensables à la réussite de la transition écologique. Certains affirment que le développement des énergies renouvelables sera empêché à cause de la pénurie inéluctable des terres rares. D’autres affirment que les progrès technologiques nous permettront de ne plus faire appel à celles-ci. Qu’en est-il vraiment ?…
L’hydrogène : un matériau d’avenir pour stocker et transporter de l’énergie ?
• L’intérêt de l’hydrogène (H2) dans le domaine de l’énergie tient d’abord au fait que 1 kg d’hydrogène permet de stocker autant d’énergie que ~ 4 litres d’essence (ou 3kg). Il réagit facilement avec le dioxygène pour donner de l’énergie thermique (combustion) ou électrique (pile à combustible).
• Il peut être utilisé pour stocker ou transporter de l’énergie et, dans certaines conditions, il concurrencera l’électricité. Mais 1 kg de H2 gazeux occupe un volume environ 2 800 fois plus grand que 4 l d’essence dans les conditions ordinaires de pression et de température. Pratiquement, qu’il s’agisse de stockage ou de transport, le gaz est souvent comprimé dans des bouteilles en acier à une pression pouvant atteindre 700 fois la pression atmosphérique (à cette pression, en prenant en compte la masse du réservoir, la densité d’énergie par kg est réduite d’un facteur ~15). On développe aussi des procédés de stockage de H2 dans des matériaux solides, avec des densités d’énergie comparables à celle assurée par une compression à 700 bars.
• H2 peut s’enflammer avec l’air et/ou exploser en cas de fuite. Comme c’est le cas pour de nombreux produits inflammables, son utilisation demande donc des précautions particulières.
• Aujourd’hui, plus de 90% de H2 est obtenu à partir d’hydrocarbures, mais il peut aussi être produit par électrolyse de l’eau, c’est-à-dire à partir d’électricité et d’eau, avec un rendement énergétique qui peut atteindre, voire dépasser 80%. La production par électrolyse ne génère aucune pollution.
• On peut aussi produire H2 par des procédés biologiques, à partir de la biomasse ou de certains déchets. Cette production est concurrencée par celle de méthane.
• La façon la plus prometteuse d’utiliser l’énergie chimique de H2 est de mettre en œuvre une pile à combustible. De l’énergie électrique est alors directement obtenue de H2 et O2 avec un rendement de 50% à 60% aujourd’hui (plus de 90% bientôt) et un moteur peut convertir cette énergie électrique en énergie mécanique avec un rendement proche de 1. Cet usage de H2 produit de l’eau et n’est accompagné d’aucune pollution.
• Il existe aujourd’hui des voitures et des autobus électriques utilisant le H2, bientôt des trains et même des « vélos ». Un kg de H2 permet à une voiture « ordinaire » de parcourir une soixantaine de km. Mais ce qui manque encore, c’est un réseau dense de distribution de ce gaz.
• H2 est susceptible d’être très largement utilisé pour stocker et transporter de l’énergie. En particulier, il pourrait être fait largement appel à ce gaz pour le stockage de l’électricité des sources intermittentes dans les périodes de surproduction…
L’électricité dans la transition énergétique
L’électricité tient une place à part dans le mix énergétique : ce n’est pas une énergie directement disponible dans la nature. Sa production est le résultat d’un processus industriel où une énergie primaire (pétrole ou charbon, vent ou énergie solaire, énergie potentielle d’une chute d’eau) est convertie en électricité.
La production mondiale d’énergie dite primaire représente, en 2017, 14 milliards de tonnes d’équivalent pétrole (TEP). Les énergies fossiles classiques atteignent 81 % du total et l’électricité « directe » (nucléaire, hydraulique, EnR et un peu de biomasse) 10 % du total.
RECHERCHE PAR THÈME
Les Cahiers Rationalistes
• Javier – février 2026
Raison Présente
• Décembre 2025


