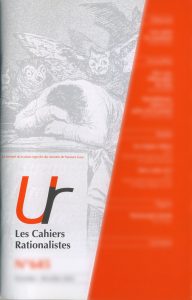Cahier Rationaliste N°646 Janvier-février 2017
Laïcité et polémiques électorales
Dans la présente campagne électorale pour l’élection présidentielle, le thème de la laïcité a pour l’instant surtout été évoqué lors d’une brève polémique entre deux candidats aux primaires socialistes sur le port du voile intégral. Mais il a occupé une place majeure dans le débat public tout au long des années passées, que ce soit à propos du port du voile par les salariées d’un établissement privé recevant le public (crèche Baby-Loup de Chanteloup-les-Vignes), des menus dans les cantines scolaires ou du port du burkini sur les plages. Nul doute qu’il y réapparaîtra car aujourd’hui la laïcité, pour certains, est un moyen d’attaquer la pratique publique de l’islam en France et au-delà l’islam en général. La laïcité étant une des préoccupations majeures des Cahiers Rationalistes, il n’est pas inutile, nous semble-t-il, de revenir aux fondamentaux.
On est loin du voile musulman, intégral ou pas, et du refus de certains musulmans de considérer que la femme est l’égale de l’homme. Puisque la laïcité redevient un thème des discours électoraux à droite comme à gauche, on peut commencer par s’étonner que la gauche, qui fut au pouvoir pendant cinq ans, et qui en ce moment se réclame si fort de la laïcité, n’ait pas pris de mesures pour que l’article 2 s’applique réellement en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer. Rappelons seulement que la loi de 1905 ne s’applique pas dans les trois départements d’Alsace-Lorraine annexés par l’Empire allemand entre 1871 et 1918 et que l’État, c’est-à-dire les impôts des Français, continue à y salarier les prêtres catholiques, protestants et juifs, les professeurs des écoles religieuses et la formation des prêtres. Rappelons aussi que depuis la loi Debré de 1959 les écoles privées, principalement catholiques, sont largement subventionnées par l’État si par contrat elles s’engagent à ce que leurs programmes soient les mêmes que dans l’enseignement public, ce qui est une garantie certaine. Mais les inspections sont rares et ces écoles privées ont l’avantage de ne pas participer à la carte scolaire, donc d’être libres du choix de leurs élèves à condition de ne pas faire de leur religion un critère d’exclusion. L’Église catholique, par héritage historique, bénéficie par ailleurs de la bienveillance affichée de l’État dont les représentants assistent souvent à ses cérémonies, qui assure la sécurité de ses grandes manifestations (pèlerinage de Lourdes, venue du pape etc.) et qui finance l’entretien des monuments historiques (cathédrales etc.) qu’elle utilise. Etc.
On peut être sincèrement laïque et comprendre que, pour des raisons de politique intérieure, les gouvernements de gauche, pensant qu’il y avait plus urgent à faire, aient hésité à faire entièrement appliquer la loi de 1905 en Alsace-Lorraine et dans les territoires d’outre-mer. Mais ils auraient pu prendre des mesures symboliques qui ne coûtaient rien et n’auraient guère soulevé de protestations, même de la part de la droite. Par exemple abolir dans ces territoires le délit de blasphème (enfin abrogé le 28 janvier 2017 seulement, sur initiative parlementaire) et ne plus imposer aux parents qui ne veulent pas que leurs enfants reçoivent dans une école publique une éducation religieuse de le demander par écrit. Ou, dans toute la France, interdire aux parlementaires d’utiliser leur part de la réserve parlementaire pour subventionner l’entretien de monuments religieux (principalement des églises). Au nom de la neutralité de l’État, on aurait aussi pu rappeler que l’État n’a pas à être représenté dans les cérémonies religieuses, principalement catholiques, même si hauts fonctionnaires, parlementaires et ministres ont tout à fait le droit d’y assister à titre personnel, et discrètement si possible. Au lieu de cela, l’État croit montrer sa neutralité en se faisant représenter dans toutes les cérémonies de culte ou associations religieuses, comme le CRIF (Conseil censé Représentatif des Institutions Juives de France) ou le Conseil Français du Culte Musulman, qu’il a lui-même créé. En réalité, il reconnaît ainsi leur légitimité et la légitimité de leur intervention dans la politique intérieure et extérieure française.
Appliquer la loi de 1905 sur tout le territoire français, y compris à l’Église catholique et à ses institutions, ne relève pas de l’anticléricalisme primaire. Car si l’Église catholique en France paraît moins dangereuse, elle n’en est pas moins parfois agressive, et dans des domaines cruciaux. On sait la part qu’elle a prise dans les manifestations contre le « mariage pour tous ». Plus graves sont ses prises de position contre la contraception et l’avortement, qui ont aussi et surtout des conséquences importantes sur la natalité en Afrique, la surpopulation et donc les crises humanitaires et les migrations de masse. Aujourd’hui même (25 janvier 201 7), le très sympathique pape François vient d’obtenir la démission du Grand Maître de l’Ordre de Malte, organisation caritative catholique peu progressiste pourtant, apparemment coupable d’avoir toléré la distribution de préservatifs comme moyen d’empêcher la propagation du SIDA. Aux USA (où il existe aussi des Églises protestantes très réactionnaires), mais en France aussi, l’Église catholique agit auprès des parlementaires qu’elle influence pour limiter au maximum l’éducation sexuelle, la distribution de contraceptifs et l’avortement. C’est son droit, mais c’est aussi le droit des laïques de ne pas l’y aider indirectement en la subventionnant et en lui décernant des brevets de bonne conduite.
Appliquer la loi de 1905 sur tout le territoire français, y compris aux institutions catholiques et juives (les institutions protestantes posent moins de problèmes), aurait l’avantage de pouvoir l’appliquer aux organisations musulmanes sans risque de se voir qualifier d’islamophobe ou de raciste et ainsi donner du grain à moudre aux extrémistes musulmans. La loi doit être la même pour tout le monde et le moyen de le faire admettre est de l’appliquer à toutes les religions. Les discours actuels de beaucoup d’hommes politiques de droite comme de gauche, ceux de l’Église de France aussi, transforment la laïcité en instrument de lutte contre le seul islam. Ce n’est pas rendre service à l’idée laïque.
Reste qu’on n’est plus en 1905 et que la société a beaucoup changé. En 1905 on n’a pas interdit les cornettes, on n’a pas expulsé les nonnes des hôpitaux et des hospices, et on n’a pas donné de contravention aux veuves qui suivaient les convois funéraires avec un épais crêpe noir sur le visage. Dans les années cinquante, on n’a pas interdit aux prêtres ouvriers de porter une croix, aux étudiants juifs de se coiffer d’une kippa, et aux immigrés travaillant sur les chaînes des usines de porter la barbe, la calotte ou des pantalons courts. L’activisme religieux de nos grands alliés et clients, l’Arabie Saoudite et le Qatar, le prosélytisme accru des imams ou imams auto-proclamés, l’apparition d’un communautarisme à fondement religieux et surtout la création d’organisations extrémistes musulmanes extrêmement violentes et meurtrières ont amené une tension dans la société française dont on ne peut pas ne pas tenir compte. Elle impose un élargissement de la laïcité, par exemple l’interdiction du port de signes religieux et de certaines tenues vestimentaires par les employés de services accueillant du public (transports, hôpitaux, crèches, mairies etc.) et la création de règlements internes interdisant ces mêmes signes religieux dans les entreprises soumises à des tensions communautaristes. Elle impose aussi à ceux qui utilisent ces services publics ouverts à tous d’en respecter les règles de fonctionnement même si elles ne correspondent pas à des traditions, préjugés et habitudes qu’eux-mêmes qualifient de religieuses. Cela relève de la loi et se fait peu à peu, bien que trop lentement.
Quant à l’interdiction du port du niqab, de la burqa ou même du foulard dans la rue, elle ne relève pas de la laïcité. Elle relève soit de préoccupations de sécurité publique (identification des personnes), soit d’une volonté de réagir contre des attitudes jugées agressives et mettant en danger notre conception, actuelle, récente, et fruit de longues et difficiles batailles, des droits de la femme et des rapports entre sexes. On peut légiférer au nom de ces principes, de même que l’on a pris des lois pour interdire les mutilations génitales (infibulation, excision) ou imposer l’égalité salariale. Mais on ne peut le faire au nom de la laïcité qui impose la neutralité de l’État en matière de croyances personnelles. Certes, dans les conditions actuelles, beaucoup de musulmans crieront à la discrimination, en oubliant que des millions de femmes musulmanes très croyantes ne sont pas voilées, ou très légèrement, et que celles qui portent le niqab ou la burqa le font le plus souvent parce qu’elles y sont contraintes. Dans trop de pays, celles qui tentent d’y échapper risquent le vitriol ou la mort décrétée par la famille ou les tribunaux islamiques.
Gérard Fussman