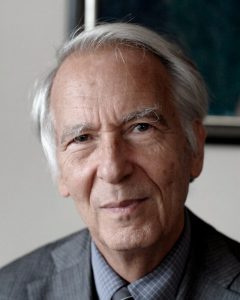
Philippe d’Iribarne
18 décembre 2006
Le débat nucléaire entre science, mythes et sagesse des nations ; la question des déchets
Les réactions des Français à l’égard des déchets nucléaires sont souvent qualifiées d’irrationnelles, Quand on les interroge longuement, il apparaît, certes, que, pour la plupart, ils n’ont qu’une connaissance fort sommaire des aspects techniques de la question et font largement appel à des représentations mythiques. Mais, pour se faire un point de vue, ils s’appuient également sur des éléments de sagesse des nations, sur une expérience des hommes et sur des réflexions éthiques dont les experts gagneraient à tenir compte.
Les réactions de l’opinion à la question des déchets nucléaires constituent un sujet sensible. En France, en particulier, il est bien apparu qu’il était impossible de construire une politique réaliste de gestion de ces déchets en faisant abstraction de ces réactions. Celles-ci ont joué un rôle essentiel dans la décision prise en 1991 de suspendre toute décision définitive en la matière et d’entreprendre de multiples recherches permettant d’avoir une connaissance beaucoup plus précise des voies possibles. La difficulté à faire passer des messages mettant en avant les aspects de la question relevant de la physique, de la géologie ou de la science des matériaux, a pu parfois donner l’impression qu’on avait affaire à des réactions éminemment affectives qu’il était vain de chercher à comprendre. La recherche que nous avons entreprise s’est proposé de chercher ce qui pouvait se cacher derrière cette irrationalité apparente : comment les opinions se construisent-elles ? Comment les fantasmes et les éléments de réalité se mêlent-ils ?
À écouter des Français ordinaires parler de cette question, on est frappé par le contraste entre d’un côté l’étendue de leurs incertitudes et de leurs doutes et d’un autre leur capacité à parler du sujet, souvent avec une certaine pertinence. La recherche a permis de comprendre ce qui rend ces deux traits cohérents. Au-delà des différences entre personnes interrogées, des disparités considérables de connaissances, et de la diversité des opinions (et en particulier des sentiments globaux vis-à-vis du nucléaire en général), un fond commun de représentations s’est nettement dégagé.
Quels savoirs ?
Quand on demande aux Français d’exprimer leur vision des déchets nucléaires, ils font appel à quatre formes de savoir : un savoir technique portant sur les déchets proprement dits ; un savoir, qui relève de la sagesse des nations, portant sur la capacité générale des humains à maîtriser le monde ; un savoir politique portant sur les humains qui sont chargés de gérer les déchets ; et enfin un savoir mythique qui fournit des images plus ou moins fantastiques, qui servent, par analogie, à penser ce qu’on ne sait pas penser autrement. Ces divers savoirs se combinent, et réagissent les uns sur les autres, pour conduire, en fin de compte, à construire des opinions.
Pour la plupart, le savoir technique concernant les déchets est très réduit. Les Français ne savent pas à quoi les déchets peuvent ressembler, s’ils sont solides, liquides ou gazeux, quel est leur volume, pendant combien de temps ils resteront radioactifs. Beaucoup ignorent même que leur radioactivité décroît avec le temps. Ils ont beaucoup de mal à se figurer des périodes qui se comptent en centaines de milliers d’années, ne voient guère de différence entre cent mille ans et un milliard d’années. En outre, ils n’ont qu’une idée sommaire des propriétés physiques de ce qui peut servir à stocker les déchets, au-delà du fait que la terre comporte des failles génératrices de tremblements de terre destructeurs et des fissures par lesquelles bien des choses peuvent passer, que le verre se casse et que l’acier s’oxyde. Ils déclarent du reste volontiers qu’ils ne sont ni physiciens ni géologues.
Par contre, tous ont un certain nombre d’idées empruntées à la sagesse des nations, idées que l’on peut résumer par la formule « les hommes ne sont pas des dieux ». Pour être capables de savoir comment un système technique, quel qu’il soit, va évoluer sur des temps qui défient l’imagination, il faudrait, affirment-ils en chœur, que les hommes échappent aux limites de l’humanité. Il y a bien des choses dans le monde d’aujourd’hui, et a fortiori dans le monde de demain, qui échappent aux savants autant qu’aux ignorants. L’histoire ne le montre-t-elle pas, elle qui fourmille en situations où les plus savants ont méconnu, en toute bonne foi, une part de la réalité. Ainsi, Marie Curie ne connaissait pas les dangers du radium.
Un troisième registre de savoir concerne les hommes : jusqu’où, savants, politiques, industriels, écologistes, sont-ils dignes de confiance ? Peut-on compter sur eux pour agir de manière responsable ? Pour dire la vérité ? Des images toutes faites se combinent avec l’expérience du passé (et en particulier la manière dont le passage du nuage de Tchernobyl a été géré en France), pour apporter des réponses nuancées. Les savants sont vus comme plutôt responsables et honnêtes, mais pas toujours ; ils sont prêts à prendre leurs désirs pour des réalités quand ils affirment maîtriser les situations (cf. la vache folle, etc.). On peut craindre que l’appât du gain ne conduise les industriels, surtout s’il s’agit d’entreprises privées, à négliger les questions de sécurité. Il revient à l’État d’être le gardien de l’intérêt général, mais il faut se méfier des politiques.
Dernier registre, enfin, celui des images et des mythes. Comment se représenter des déchets dont on ne sait pas grand-chose, si ce n’est qu’on est incapable de les faire mourir et qu’ils peuvent faire du mal ? Comme un être à la fois malfaisant et immortel, capable de survivre à toutes les prisons où on prétend l’enfermer et prêt à profiter de la moindre occasion, du moindre défaut de la cuirasse, pour accomplir son œuvre de malheur ; un être qu’il ne faut surtout jamais laisser abandonné sans surveillance et à qui, si l’on veut enfin être en paix, il faut arriver un jour à ôter son pouvoir maléfique en le « dénucléarisant ». Le comportement des hommes prend sens, lui aussi, en référence à des images mythiques. Deux d’entre elles font particulièrement référence, pour le meilleur et pour le pire : d’un côté l’image du jardinier prudent et raisonnable, qui ne craint pas de modifier la nature pour lui faire rendre des fruits, mais sans oublier de l’entretenir, de veiller sur elle, d’assurer sa conservation ; de l’autre l’image de l’apprenti sorcier qui, troublant sans réflexion l’ordre naturel, déclenche des forces qu’il ne maîtrise pas.
Une dimension éthique
La forme de préoccupation qu’expriment les Français vis-à-vis des déchets radioactifs est singulière. Peu sont vraiment inquiets pour eux-mêmes. Mais la plupart sont mus par un questionnement à caractère éthique : quel monde allons-nous léguer à nos enfants et, plus largement, à l’humanité future ? Nous n’avons pas le droit, affirment-ils massivement, d’embarquer notre descendance, sans que celle-ci ait eu son mot à dire, dans une aventure sans limites, et qui l’est à un triple titre :
- on a affaire, avec les déchets radioactifs, à quelque chose qui restera vivant, et donc menaçant, pendant des temps à l’échelle desquels l’homme n’est rien ;
- cette durée de vie quasi infinie promet un envahissement progressif de la planète lui aussi sans limites ;
- personne ne connaît réellement l’ampleur des dangers que l’on court, et surtout que courront nos descendants, et personne ne peut réellement garantir, vu là encore l’échelle de temps concernée, qu’ils ne soient pas immenses, que le sort même de l’humanité ne sera pas un jour enjeu.
Les Français craignent que, refusant de voir la réalité en face, on abandonne pour toujours sans surveillance quelque chose (un être) dont on ne sait pas ce qu’il réserve. Enterrer un tel être et le laisser vivre sa vie sans plus s’en occuper, en déclarant que la sorte de cercueil où on l’a enfermé résistera dans l’infini des temps à la corruption des matériaux qui le composent et à l’instabilité de la terre, est largement perçu comme totalement irresponsable.
C’est à l’aune de telles attentes, en se demandant si elles sont susceptibles de les satisfaire, que les solutions techniques susceptibles d’être adoptées pour gérer les déchets sont jugées.
Les experts restent-ils dans leur rôle ?
Compte tenu de ces éléments, on voit coexister, chez les mêmes personnes, des réactions vis-à-vis des politiques susceptibles d’être suivies et des experts à l’origine de ces politiques, qui relèvent de deux registres radicalement différents.
D’un côté, on trouve la prétention prêtée à certains des responsables du nucléaire, experts en tête, à enfermer les déchets pour les siècles des siècles dans une sorte de boîte parfaitement cadenassée, de façon telle qu’ils cessent totalement d’être une menace pour l’humanité future. L’évocation d’une telle prétention suscite massivement une réaction de rejet : les hommes, affirment en chœur les personnes interrogées, sont incapables de prévoir ce qui peut se passer sur des périodes de temps qui défient l’imagination ; considérée sur une telle durée, affirment-elles encore, la nature échappe à leur maîtrise ; elle réserve des surprises dont absolument personne, les savants pas plus que les ignorants, ne peut avoir idée aujourd’hui ; elle est susceptible de déjouer les plans les mieux conçus ; quelque assurance que l’on prenne, il finira bien un jour par se passer des choses que l’on n’aura pas prévues, et l’abîme dont on avait cru se protéger s’ouvrira alors malgré tout ; il est impossible de cerner aujourd’hui quelle serait l’ampleur de la catastrophe qui risque alors de se produire.
On a là une objection que l’on peut qualifier de métaphysique : le fini (l’homme) ne peut pas maîtriser l’infini (la nature dans l’infini des siècles). Une telle objection a sans doute à voir avec les mythes d’Adam, d’Icare ou de l’apprenti sorcier, qui, les uns et les autres, ont refusé d’assumer la finitude de l’homme et s’en sont trouvés cruellement punis (ainsi l’apprenti sorcier a cru pouvoir enfermer le mauvais génie dans une bouteille et a bien fermé le bouchon, mais il était fatal qu’un jour ou l’autre un événement imprévu permette à l’esprit maléfique d’en sortir). Cette vision des choses, qui s’ancre dans l’expérience millénaire de l’humanité, s’exprime par le truchement d’adages (« ça n’existe pas la perfection », « le risque zéro n’existe pas », etc.). Elle est de plus périodiquement confortée par des épisodes tels que ceux de l’amiante, du sang contaminé, de Tchernobyl, etc.
Cette vision entre en jeu à propos des déchets nucléaires comme elle le ferait dans n’importe quel domaine de l’existence. Il suffit, pour qu’elle s’impose, de savoir que la durée de vie de ces déchets défie l’imagination. Peu importe dès lors que l’on ait ou non une idée plus précise des déchets eux-mêmes et des moyens sur lesquels on compte pour s’en mettre à l’abri. Il n’est pas besoin non plus de penser que tel ou tel événement précis risque de se produire. De toutes façons comment ne pas croire, vu l’échelle de temps en cause, que tôt ou tard il se passera quelque chose de dramatique même si l’on est aujourd’hui hors d’état d’imaginer ni ce que cela pourra être ni quand cela adviendra ?
Les connaissances plus précises que les personnes interrogées peuvent avoir sur tel ou tel aspect de ce qui touche aux déchets s’intègrent sans mal dans une telle vision. Le caractère peu prévisible des tremblements de terre, la dérive des continents, l’instabilité du climat, l’existence du terrorisme, le caractère mortel des civilisations, sont autant d’éléments susceptibles d’alimenter la conviction que toute prétention à faire en sorte que l’on soit parfaitement protégés des déchets, alors même qu’ils demeurent pleinement actifs, est illusoire. Mais si ces éléments nourrissent cette conviction, ils ne la fondent pas.
Face à une conviction de cette nature, les propos d’experts visant à convaincre de ce que la situation est maîtrisée, qu’on a trouvé un moyen de protéger l’humanité du caractère néfaste des déchets dans l’infini des temps (ou ce qui paraît tel), pèsent peu. Peu importe la qualité, si éminente soit-elle, des travaux scientifiques qui sous-tendent l’argumentation déployée. On est dans un registre où les savants, qu’ils soient physiciens, géologues, chimistes ou autres, et les ignorants sont vus comme à égalité. Plus encore, peut-être, les savants sont soupçonnés de succomber à des illusions auxquelles le bon sens populaire permet, pense-t-on, de résister. Au mieux de tels propos conduisent simplement à ranger les experts, regardés comme sincères, dans la catégorie de ceux qui sont victimes d’une illusion de maîtrise. Au pire ces derniers seront accusés de mentir pour défendre de bas intérêts.
Une question radicalement différente concerne la façon la moins mauvaise de traiter, dans l’immédiat et dans les décennies à venir, les déchets existants et ceux que le parc nucléaire produira de toutes façon. Là, il ne s’agit plus de prétendre maîtriser l’infini des temps, mais d’apporter des solutions concrètes, avec leurs limites, à des problèmes circonscrits, au fur et à mesure qu’ils se présentent. On n’est plus dans un registre métaphysique, mais dans un registre technique. Dès lors, les experts sont bien dans leur rôle et retrouvent tout leur lustre. On ne peut plus leur opposer de savoir commun vis-à-vis duquel ils n’ont aucune supériorité par rapport au profane (voire même, ils sont en position défavorable, étant suspects d’être aveuglés par le fait d’être juge et partie). Certes, les profanes peuvent encore avoir des avis (par exemple sur des questions de profondeur d’enfouissement, ou de risques inhérents à un entreposage en surface), mais en étant en général très conscients des limites de ceux-ci, voire du fait qu’ils sont susceptibles de reposer sur de purs fantasmes. Ces avis ne relèvent pas de convictions bien ancrées et sont susceptibles d’être modifiés par une information adéquate. Le savoir technique est alors en position dominante, à la seule condition que ceux qui le mettent en œuvre paraissent compétents et honnêtes. Souvent, du reste, le sentiment des citoyens ordinaires par rapport aux experts est du type : « Qu’ils fassent leur travail, qu’ils mettent en œuvre les manières de faire les plus adaptées ; nous sommes prêts à leur faire confiance ».
Le lien entre les deux questions vient de ce que si les experts, en prétendant maîtriser les déchets par delà les siècles, semblent tenter d’usurper un rôle dans lequel ils ne sont pas légitimes, cela menace leur crédibilité dans le rôle qui leur est reconnu : le rôle de recherche, au sein du temps des hommes, des solutions qui, avec leurs limites, sont les moins mauvaises possibles à des questions trop complexes pour que le profane puisse les maîtriser.
Les attentes à l’égard des responsables
Les Français attendent deux choses des responsables :
- qu’ils fassent en sorte que, grâce au progrès de la science, on devienne capable, le plus tôt possible, de recycler les déchets radioactifs de manière à les faire disparaître, ou de les transformer en déchets ordinaires, privés de leur radioactivité ;
- qu’en attendant que ce jour advienne, on s’organise pour les surveiller attentivement, de manière à pouvoir réagir sans délai si, pour une raison quelconque, ils deviennent immédiatement menaçants.
Cette attente est alimentée par une croyance au progrès qui relève largement d’une sorte de foi du charbonnier. Elle anticipe, en ce qui concerne la disparition à terme de tout caractère radioactif des déchets, sur ce que les scientifiques sont capables aujourd’hui de promettre avec certitude. Mais elle ne demande pas l’impossible. En particulier les Français savent bien que les progrès de la science prennent du temps et se doutent plus ou moins confusément que tout n’est pas forcément réalisable. Ils veulent en tout cas que la génération présente fasse de son mieux, se donne les moyens de réaliser quelque chose qui ne sera certes pas parfait (la perfection n’est pas de ce monde), mais qui permettra de faire rentrer du mieux qu’on peut la question des déchets dans les limites de la vie ordinaire de l’humanité. Et, mieux on arrivera à un tel résultat, plus on pourra accepter le nucléaire comme une source pérenne d’énergie.
Dans l’ensemble ils réagissent plutôt favorablement à l’idée d’un stockage géologique, soigneusement surveillé et entretenu, et qui reste réversible, dans l’attente d’une « vraie solution » à la question des déchets. Mais ils ne se sentent guère compétents pour dire quelle solution technique précise il convient d’adopter. Ainsi, en attendant de pouvoir un jour recycler les déchets ou les débarrasser de leur radioactivité, vaut-il mieux les stocker en surface, à 50 m de profondeur, ou à 500 m, les laisser à la Hague ou les mettre ailleurs ? Ils ont bien quelques opinions sur le sujet, mais elles ne sont pas bien arrêtées et ils font largement confiance aux experts pour trancher.
La question du temps qui va être nécessaire pour obtenir autant que possible le recyclage ou la neutralisation des déchets nucléaires demeure un point sensible. Deux références, inégalement contraignantes, interviennent simultanément :
- la première est le temps d’une génération, temps dont celle-ci dispose pour régler les problèmes qu’elle a créés, évitant ainsi de les « refiler » non résolus à l’humanité future ;
- la seconde correspond au temps de la transmission, temps pendant lequel les générations successives sont capables de veiller sur un système technique et d’en confier le soin à la génération suivante, dans des conditions qui assurent que ce système reste bien maîtrisé.
Pour qu’une combinaison de stockage immédiat et de transformation à terme soit crédible, il est en tout cas nécessaire qu’une telle transformation se réalise dans des délais compatibles avec le temps de la transmission. Mais, idéalement, beaucoup souhaiteraient que l’on fasse mieux et que le temps d’une génération suffise. A défaut, c’est en tout cas un devoir pour la génération présente d’utiliser ce temps pour faire progresser la science. Et le legs fait aux générations futures sera moralement plus acceptable si ce qu’on leur transmet aujourd’hui comme déchet promet d’être un jour une source précieuse d’énergie ou de matières premières.
Conclusion : deux irrationalités qui se rencontrent
Il n’est pas faux de parler de l’irrationalité des Français ordinaires dans leurs réactions à l’égard des déchets nucléaires. Il est vrai que la vision qu’ils en ont est largement faite d’ignorance et de pensée mythique. Mais cette forme d’irrationalité est largement alimentée par une autre irrationalité : celle des experts. Celle-ci a elle aussi rapport avec la peur. Elle cherche à conjurer cette peur par une illusion de toute puissance, de parfaite maîtrise du monde. Et plus les experts s’abandonnent à cette illusion, plus les citoyens ordinaires voient en eux une source de menace, portée par l’image de l’apprenti sorcier, au lieu de les ressentir comme une source de protection ; plus, dès lors, ces Français ordinaires se trouvent renforcés dans leur peur d’un monde qui les dépasse et dans leur propre forme d’irrationalité. Un retour à plus de rationalité ne peut être que partagé, empreint simultanément de confiance d’un côté, de modestie et de conscience de ses limites de l’autre, dans une juste appréhension commune des capacités des hommes à maîtriser le monde qu’ils habitent.


