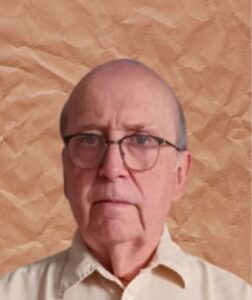Cahier Rationaliste N°694 - Janvier-février 2025
Elles sont l’avenir des sciences : Entretien avec Michèle Leduc

Entretien avec Michèle Leduc
Pour poursuivre la nouvelle rubrique dans les Cahiers Rationalistes « Elles sont l’avenir des sciences », j’ai le grand plaisir de m’entretenir avec Michèle Leduc que les adhérents de l’UR connaissent bien.
Marc Thierry : Michèle Leduc, vous êtes une chercheuse en physique quantique, aujourd’hui directrice de recherche émérite au CNRS. Vous êtes aussi une fidèle militante à l’Union rationaliste, corédactrice en chef de la revue Raison Présente. Je souhaiterais, à l’intention des jeunes filles (et des jeunes hommes !), que vous présentiez comment vous en êtes arrivée à ce point de votre carrière scientifique, quelles ont été vos motivations, les difficultés et les joies de votre parcours. Et d’abord, pouvez-vous évoquer votre enfance, vos études ?
Michèle Leduc : J’ai grandi après la guerre dans un milieu modeste, à une période où la vie quotidienne était difficile pour la grande majorité des Français. Ma mère, fille d’immigrés belges, était institutrice. Elle avait bénéficié d’une formation très stricte mais de qualité à l’École Normale pour jeunes filles de Saint Germain en Laye, à laquelle elle avait accédé poussée par un professeur en tant que très bonne élève. Elle n’avait pas pu poursuivre ses études dans le supérieur malgré d’excellents résultats, car ses parents avaient besoin du salaire de leur brillante fille de 19 ans à sa sortie de l’École Normale. C’est ainsi qu’elle est devenue maîtresse d’école de maternelle dans une banlieue parisienne peu favorisée. Quant à mon père, il a eu encore moins de chance de pousser ses études qu’il a dû arrêter au niveau du brevet pour contribuer au budget familial ; il s’est alors fait embaucher comme technicien supérieur, bientôt cadre à la SNCF. Tout au long de sa vie, il a poursuivi son éducation personnelle en autodidacte, apprenant chaque matin, avant le lever de la famille, le déchiffrage des hiéroglyphes ou des éléments de mathématiques. Je lui dois mes spectaculaires résultats en géométrie en classe de 4e.
C’est à mes parents que je dois le goût et le plaisir d’étudier, et mon insatiable appétit pour les livres qu’ils ne censuraient pas. Il était d’ailleurs hors de question que je ne sois pas excellente élève à l’école. Il ressort de tout ceci que je ne suis pas une héritière au sens bourdieusien du terme, à la différence de la plupart de mes condisciples à l’École Normale Supérieure de jeunes filles de Sèvres ; j’ai réussi le concours après une austère préparation au lycée Fénelon à Paris, lui aussi alors réservé aux filles. Je suis donc, avec ma sœur chimiste Élisabeth, la première génération qui a pu accéder aux études supérieures dans notre famille : l’ascenseur social qu’était l’école ? fonctionnait encore bien dans ma jeunesse.
M. T. : Comment votre vocation pour les sciences s’est-elle dessinée ? Lorsque que vous avez commencé votre carrière de chercheuse, le choix de la physique quantique comme domaine de recherche, peut surprendre après les tragédies de Hiroshima et de Nagasaki. C’est une science ayant un impact majeur sur le monde moderne.
M. L. : J’ai longtemps hésité avant de choisir les sciences. Au lycée j’étais plutôt portée sur la littérature et j’adorais avant tout rédiger des dissertations. Parmi les valises de livres que je remportais chaque année après la distribution des prix, je m’attachais particulièrement à ceux écrits par des femmes admirables. J’ai le souvenir d’avoir particulièrement chéri Mrs Dalloway de Virginia Woolf et surtout Voyage d’une parisienne à Lhassa de l’intrépide
Alexandra David-Neel, contrainte de se déguiser en homme pour devenir exploratrice au début du xxe siècle. J’ai failli lâcher la « taupe » pour passer en « khâgne » avant le concours de l’ENS : c’est par obéissance à ma mère, féministe radicale, que j’y ai renoncé : elle voulait pour sa fille un « vrai métier d’homme », comme seules peuvent en procurer les sciences selon les idées reçues de son époque et de son milieu. C’est ainsi que j’ai renoncé à la littérature et je ne l’ai pas regretté.
À l’ENS de Sèvres j’ai choisi la physique, par envie de travailler concrètement à monter des expériences de mes mains, plutôt que les mathématiques pour lesquelles je savais ne pas avoir le génie requis pour une recherche originale.
J’ai commencé par la physique nucléaire pour mon diplôme à Orsay avant l’agrégation, mais je l’ai rapidement abandonnée : d’une part je ne voyais pas bien ma place, diluée dans une vaste collaboration de plusieurs dizaines de chercheurs ; d’autre part j’avais une certaine conscience que la réflexion de mes collègues était un peu courte quant aux risques potentiels de la fission ; j’ai très tôt adhéré au mouvement Pugwash contre les armes Bnucléaires.
M. T. : Comment avez-vous réussi à trouver votre place, en tant que femme, dans ce laboratoire ? Pouvez-vous détailler un peu vos activités dans la recherche, le travail en équipe ?
M. L. : J’ai démarré ma thèse dans la foulée du prix Nobel décerné en 1966 à Alfred Kastler pour la découverte du pompage optique, qui consiste à manipuler les spins des atomes avec de la lumière en jouant sur la conservation du moment cinétique dans les échanges entre les atomes et des photons polarisés circulairement. J’ai démarré une collaboration avec Franck Laloë pour montrer qu’on pouvait étendre cette méthode pour orienter les spins des
noyaux au cœur des atomes. Dans un gaz d’He3, l’isotope impair de l’hélium, nous avons réussi à créer une polarisation nucléaire mesurable. Nous avons pu alors mettre en évidence des effets macroscopiques surprenants que nous avions prédits théoriquement, conséquences du principe d’exclusion de Pauli en mécanique quantique, telle la modification de la conduction de la chaleur par la polarisation des spins des noyaux à l’échelle microscopique.
Après la découverte du laser, la physique atomique s’est trouvée profondément bouleversée dans les années 1970 quand on a réussi à fabriquer de tels outils lumineux accordables à volonté en longueur d’onde. Comme il n’en existait pas à la longueur d’onde infra-rouge de l’hélium, j’ai fait le pari d’en fabriquer un moi-même, mettant en chantier toutes les méthodes imaginables, allant jusqu’à traverser l’Atlantique pour ramener dans mes bagages des cristaux irradiés dans une thermos contenant de l’azote liquide. Cette quête m’a coûté plus de deux ans sans publication, un luxe qu’un jeune chercheur ne pourrait plus se permettre de nos jours. « Mes premiers lasers pour l’hélium m’ont fait connaître une cinquantaine de labos dans le monde qui en avaient besoin. J’ai ainsi fait une jonction inattendue avec un laboratoire allemand, avec lequel j’ai développé une méthode inédite d’imagerie des poumons par IRM avec du gaz d’He3 polarisé inhalé par un patient-cobaye. Par ailleurs, ce gaz comprimé sous forte pression peut constituer une cible pour polariser des faisceaux de neutrons destinés à tester des matériaux en physique du solide. La méthode est toujours utilisée dans certains réacteurs nucléaires.
Au LKB j’ai eu la très grande chance d’être à mi-carrière associée à l’équipe de Claude Cohen Tannoudji, professeur au Collège de France, qui avait introduit en France les « atomes froids » dans les années 1980. La méthode consiste à porter, par des techniques lasers appropriées, un petit échantillon gazeux de quelques millions d’atomes maintenu dans l’ultravide à une température d’un milliardième de degré au-dessus du zéro absolu. Elle a révolutionné la physique atomique, dévoilant des propriétés inconnues de la matière. J’ai été ainsi incorporée dans une équipe de jeunes chercheurs brillants venus de partout dans le monde. L’excitation était intense, nous travaillions même la nuit pour éviter les vibrations du sol liées au passage du RER. La moisson de résultats a été fantastique et j’ai eu le privilège d’accompagner Claude Cohen Tannoudji pour la réception de son prix Nobel à Stockholm en 1986.
M. T. : Vous êtes membre et active dans l’association « Femmes et Sciences » depuis sa création. Comme femme dans la science, avez-vous été confrontée vous-même à des difficultés particulières ?
M. L. : J’ai eu beaucoup de chance dans le choix de mon laboratoire, car les directeurs Kastler et Brossel n’étaient pas misogynes, contrairement à beaucoup d’autres à l’époque, y compris à l’ENS. Au démarrage je me suis trouvée isolée, seule sur ma manip et sans vrai directeur de thèse. Il y avait alors très peu de femmes dans le laboratoire, j’étais entourée de collègues masculins, assez amicaux mais malgré tout très peu féministes. Quand j’ai rencontré les premières difficultés, au lieu d’une aide j’ai reçu de presque tous des suggestions bienveillantes du genre : « l’enseignement secondaire serait très bien pour toi, c’est la carrière idéale pour une femme agrégée, avec du temps pour s’occuper des enfants, des vacances en même temps qu’eux, etc. » Je serai éternellement reconnaissante à cet autre collègue qui, au coin d’un couloir un jour de déprime, m’a donné le conseil qui m’a sauvée : « trouve toi-même un nouveau sujet de thèse, redémarre, ne reste pas seule, travaille ! » Au cours de ma longue carrière de chercheuse, je n’ai heureusement pas rencontré de problèmes de harcèlement sexuel, contrairement à bien d’autres. J’ai accueilli en souriant les compliments sur mon physique et les courtoises propositions de flirt, qui ont d’ailleurs pris fin quand je suis montée en grade et devenue directrice du laboratoire. Par contre, j’ai souvent souffert d’une forme légère de harcèlement moral : mon nom oublié dans la présentation des travaux de mon équipe lors de la visite d’un professeur étranger, mes propositions ignorées lors d’une réunion de brainstorming, mais reprises par un collègue masculin et discutées par le groupe comme si elles venaient de lui, les regards qui ne s’arrêtaient jamais sur moi pendant une discussion scientifique… Cette situation s’est reproduite aussi à de multiples occasions au cours de mes activités dans l’administration de la recherche, par exemple quand j’ai été directrice scientifique pour la physique et les sciences de l’ingénieur au ministère de la Recherche. Heureusement le pouvoir (relatif) de distribuer l’argent de l’État compense à l’occasion l’« infériorité de genre ». J’ai été fortement motivée pour participer au démarrage de l’association « Femmes & Sciences » créée en 2000 avec Claudine Hermann, une amie dont j’avais suivi les travaux de thèse sur le pompage optique dans les semi- conducteurs. Très modeste au départ, fondée surtout sur des chercheuses confirmées en physique et mathématiques, cette association n’a fait que se développer depuis. Elle compte à ce jour des ingénieures, des juristes, des chercheuses en sciences sociales, nombre de jeunes (mais quasiment pas d’hommes). J’y ai contribué de multiples façons en tant que rôle modèle et comme ambassadrice des sciences physiques dans les classes de lycée.
Je considère aujourd’hui que cette fonction est mieux assurée par des scientifiques plus jeunes que moi, auxquelles les élèves peuvent mieux s’identifier. Par contre je me sens de plus en plus concernée par la lutte contre le harcèlement dans l’enseignement supérieur ; je recueille des témoignages, organise des rencontres et j’écris des articles dans la presse sur ce sujet douloureux.
M. T. : Nous savons à l’Union rationaliste que vous êtes une femme engagée, de conviction. Pouvez-vous nous éclairer sur vos diverses prises de position, en particulier à la Société Française de Physique ou pour l’éthique dans les sciences ?
M. L. : J’ai aimé présider la Société Française de Physique (SFP). Je n’étais que la troisième femme élue à ce poste, après des dizaines de présidents masculins depuis la création de l’association il y a 150 ans. J’y ai contribué au développement de la commission « Femmes et Physique de la SFP », qui assure une formation et fait du mentorat pour les jeunes chercheuses débutantes. Je me souviens aussi y avoir œuvré pour la coopération scientifique avec nos collègues d’Afrique du Nord, souvent nos anciens doctorants, en fondant les EPAM (Ecoles de Physique Avancée pour le Maghreb), qui n’ont malheureusement pas été poursuivies au-delà de cinq ans par mes successeurs à la tête de la SFP. Je compense actuellement ce semi-échec par une participation à la commission « Physique sans frontières » de la SFP. Je ne sais pas à quoi je dois l’honneur d’avoir été cooptée comme présidente du Comets, le comité d’éthique du CNRS. Peut-être à ma proximité au début de ma carrière avec le Professeur Kastler, grand humaniste et défenseur des droits de l’homme ; je l’aidais au temps de la Guerre froide à accueillir des chercheurs russes « refuzniks » quand ils débarquaient à la Gare du Nord sans un sou en poche… Je me suis passionnée pour les travaux du Comets où j’ai siégé pendant dix ans. Nous nous sommes d’abord focalisés sur la mécanique interne du milieu de la recherche et ses possibles dysfonctionnements, souvent peu visibles. Le Comets a ainsi fermement incité la direction du CNRS à se saisir des manquements, grands ou petits, à l’intégrité scientifique. Ceux-ci résultent pour beaucoup des pressions excessives à la publication pesant sur les chercheurs ; ils dégradent le socle des connaissances et peuvent avoir des conséquences désastreuses, par exemple pour la santé comme on l’a vu pendant le Covid. La liberté de chercheurs, bornée par leur responsabilité vis-à-vis de la société, a été un autre axe des réflexions suivantes que j’ai menées avec la petite équipe très soudée et totalement interdisciplinaire avec laquelle j’ai travaillé au Comets. D’une certaine façon je prolonge ces préoccupations pour l’éthique de la science par mon engagement actuel à l’Union rationaliste.
M. T. : Je sais que vous êtes une épouse, une mère, une grand-mère très attentionnée. Cela ne fut sûrement pas facile de se consacrer à la vie de famille et aux sciences. Comment avez-vous pu tout combiner ?
M. L. : Pour ma vie de famille j’ai eu beaucoup de chance. Quand mes deux filles étaient petites j’ai pu m’offrir une nounou fiable et efficace, mieux que la crèche car elle pouvait les garder assez tard le soir quand j’avais une manip à finir au labo. J’ai aussi abusé de la bonne volonté de ma mère pour les gardes pendant les vacances scolaires et les soirs pour mes sorties culturelles à Paris. J’ai aussi eu beaucoup de chance avec le père de mes enfants, mon premier mari maintenant décédé, qui partageait les tâches ménagères et s’occupait seul des enfants quand je partais en conférence à l’étranger. Je dois reconnaître que je n’ai suivi que d’assez loin les devoirs du soir de mes filles après l’école, elles devaient se débrouiller par elles-mêmes. Mon attention pour elles s’est portée sur la culture en leur commentant les livres de ma bibliothèque et en les emmenant souvent le dimanche au musée ou au théâtre. Elles ont finalement fait de très bonnes études supérieures qui les ont menées l’une comme l’autre dans la voie professionnelle qu’elles avaient souhaitée, l’aînée dans la création textile pour la mode, l’autre dans la recherche scientifique – heureusement que sa mère ne l’a pas dégoûté de ce métier… Aujourd’hui avec mes trois petits enfants je récidive : je suis chargée de leurs sorties culturelles ; aucune réunion ne peut interférer avec
l’après-midi du mercredi réservé à mon petit-fils de sept ans. J’ai pourtant encore beaucoup d’activités en tant que chercheuse émérite dans le domaine « à la mode » des technologies quantiques. Et j’ai retrouvé mon goût pour les lettres en me consacrant à la direction de deux collections d’ouvrages de science et à la co-rédaction de la revue Raison Présente de l’Union rationaliste.
M. T. : Je voudrais que vous donniez quelques conseils aux jeunes filles (et jeunes hommes). Il est possible d’être une grande chercheuse en physique, sans pour autant négliger la vie de famille, la vie culturelle, l’amitié, les engagements… Quels sont vos secrets?
M. L. : Je n’ai pas de secret. J’ai eu la chance de pouvoir faire ce qui me plaisait et d’être entourée de gens qui m’aiment et que j’aime. Pour un conseil aux jeunes, ce serait : donnez-vous les moyens de suivre la voie qui vous attire et travaillez pour y arriver sans vous laisser intimider ou douter de vous-même. Et particulièrement pour les filles je dirais : choisissez bien votre compagnon ! Si vous faites des études scientifiques, je pense que la rigueur qu’elles impliquent est une bonne base pour comprendre la société qui nous entoure et détricoter les fausses informations. Quant à en faire son métier : je l’aurais conseillé sans réserve quand j’étais plus jeune ; je peux témoigner que je l’ai exercé avec une certaine passion malgré les temps morts et l’angoisse des échecs en cours de route inhérents à la recherche. Pourtant le monde aujourd’hui a changé et est devenu très instable. On mesure les risques de certaines nouvelles technologies issues de la recherche qui n’ont ni le bien-être ni le progrès général dans leurs perspectives. Mon conseil final est de bien mesurer l’impact que vous visez pour vos travaux. Mais alors si vous vous lancez : même pas peur !
M. T. : Michèle Leduc, je vous remercie d’avoir répondu à ces quelques questions. J’espère que les jeunes filles (et aussi les jeunes hommes) qui vous liront auront envie, elles aussi, de se lancer dans la belle aventure des sciences.