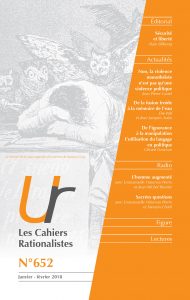Cahier Rationaliste N°664 - Janvier-février 2020
De l’ignorance à la manipulation. L’utilisation du langage en politique
Les liens de la langue et de la politique sont bien connus. Gérer un groupe humain impose de parler pour préparer les décisions, les expliquer et les appliquer. Fixer précisément ces décisions et les faire connaître a impliqué l’intervention de l’écrit dès que l’écriture fut inventée. Avant même l’apparition de la notion moderne de nation, qui remonte à la Révolution française de 1789, les conquérants et les classes dominantes ont de fait imposé l’usage de leur langue aux peuples conquis ou soumis qui ne la parlaient pas parce que les relations avec le pouvoir se faisaient forcément dans la langue de celui-ci. C’est un processus qui pour être mené à son terme sans violence demandait beaucoup de temps. Il a fallu des siècles pour que la Gaule parle un latin qui n’était pas exactement le latin de Cicéron et est devenu le français. La Germanie ne l’a jamais parlé. Les Normands n’ont pas réussi (ni vraiment cherché) à faire parler français à la Grande-Bretagne. Il a fallu des siècles pour que le parler des rois et de la noblesse d’Île de France élimine les dialectes romans également issus du latin (picard, berrichon, occitan etc.) et les langues régionales non romanes (breton, flamand, alsacien etc.). Certaines de ces dernières offrent encore une belle résistance.
À partir du 19e siècle, les choses vont beaucoup plus vite car les nouvelles nations d’Europe et du Proche-Orient se constituent à partir d’un consensus populaire, même s’il n’est pas toujours spontané, arguant de l’unité du territoire, de la langue et très souvent de la religion. En ce qui concerne celle-ci, les vieux États de l’Europe avaient déjà donné l’exemple. La paix d’Augsbourg (1555), qui marque la fin des guerres de religion allemandes, se conclut par la célèbre formule cujus regio ejus religio, signifiant que la religion d’un pays était celle de son prince. La révocation de l’Édit de Nantes fut suivie de la conversion forcée ou de l’exil plus ou moins imposé de la plupart des protestants français. Dans les Balkans, l’indépendance grecque se fit à partir de la revendication d’un passé glorieux, de l’unité de la langue et de la religion (christianisme orthodoxe). Les villes retrouvèrent leur nom antique, la Morée redevint le Péloponnèse, et l’effort patriotique s’accompagna de la création d’un nouveau grec, plus proche de l’antique que le grec alors parlé, le grec purifié s’opposant ainsi, et s’opposant toujours, au grec démotique (populaire). Quant aux centaines de milliers de musulmans hellénophones, qu’ils aient eu ou non partie à la répression ottomane (les fameux massacres de Chio), ils n’eurent que le choix entre la valise et le cercueil. Il en fut de même en Bulgarie. Il suffit de lire les journaux pour savoir qu’au Proche- Orient et dans les Balkans la même triple alliance provoque depuis 1922 (expulsion des Grecs d’Anatolie) les mêmes massacres et les mêmes exodes.
Le problème est plus complexe dans les pays colonisés dont la population n’a pas été exterminée comme ce fut le cas dans les colonies espagnoles d’Amérique latine et anglo-saxonnes d’Amérique du nord. Au Maghreb où le français n’avait pas encore réussi à éradiquer l’arabe dialectal, la tentation est grande de revenir au seul arabe, langue du Coran et langue d’un prestigieux passé. Mais c’est se couper du monde contemporain et des possibilités d’expatriation vers les pays riches. Dans les états nouvellement créés par l’écroulement des empires coloniaux en Inde et en Afrique subsaharienne, l’utilisation de la langue du colonisateur permet à des groupes humains ne parlant pas la même langue de coexister et au pays de rester en contact avec l’Occident. Mais la pression des langues dites natives du groupe humain dominant est de plus en plus importante surtout quand elles ont un riche passé et sont plus ou moins liées à la religion dominante. Le processus n’est pas terminé et il est parfois sanglant.
Les vieux pays n’en sont plus à s’étriper pour des problèmes de langue. Mais celle-ci joue encore un rôle dans l’union ou la désunion nationale. L’État français, malgré Napoléon, est toujours en butte au nationalisme corse, l’État espagnol aux nationalismes catalan et basque, la Belgique se déchire entre Flamands et Wallons, les Écossais réclament leur indépendance et les Irlandais (là, au problème de la langue, s’ajoute celui de la religion) n’ont déposé les armes que depuis peu. Il serait temps que les hommes politiques (je veux bien sûr dire : les hommes et les femmes politiques) se rendent compte de l’attachement des humains à leur langue maternelle, surtout lorsqu’ils ont l’impression d’être socialement défavorisés à cause d’elle. La République française, a dans l’ensemble, réussi dans sa politique d’unification linguistique, mais les dégâts humains ont été considérables. D’autres États ont choisi une tout autre solution et inscrit le multilinguisme dans leur constitution : la Suisse, l’ex-Union Soviétique, l’Inde, le Pakistan, l’Afghanistan etc. Cela a empêché beaucoup de rancœurs, mais pas toujours la tentation séparatiste basée sur la langue et parfois la religion. Car même en pays officiellement multilingue, il y a toujours une langue dominante, celle de l’élite politique, militaire, scientifique, économique, qu’il faut apprendre si l’on veut atteindre les degrés hauts de l’échelle sociale. Cette langue est presque toujours celle de l’ancien conquérant.
La sociolinguistique a depuis longtemps démontré une vérité d’évidence : même en pays apparemment unilingue, la langue est un facteur de différenciation sociale et donc de discrimination pour ceux qui n’en maîtrisent pas tous les codes. Si l’école n’a pas réussi à les corriger, l’accent, une maîtrise insuffisante du vocabulaire, une syntaxe appauvrie, la méconnaissance des tournures de bienséance orale et écrite sont des marqueurs de l’origine sociale et souvent un frein majeur à la réussite, y compris économique. Pour ne citer qu’un exemple, le facteur linguistique joue un grand rôle dans la ghettoïsation des quartiers pauvres des banlieues. On peut réussir une ascension sociale malgré sa couleur de peau, le nom qu’on porte, la religion que l’on pratique ou est censé pratiquer, mais pas avec une maîtrise insuffisante des codes linguistiques.
Les féministes françaises connaissent ce pouvoir discriminant de la langue. C’est pourquoi elles tentent de la féminiser. La publicité que leur ont attirée leurs efforts montre que, de ce point de vue, elles ont visé juste. En ce qui concerne la transformation à long terme des habitudes linguistiques, on peut en douter. Leurs deux dernières initiatives, l’écriture dite inclusive et l’abolition de la règle « le masculin l’emporte sur le féminin », devaient nécessairement provoquer le scandale car elles portent moins sur le français parlé de tous les jours que sur la langue de l’élite et uniquement sur la langue écrite. D’où la levée de boucliers de cette partie de l’élite intellectuelle qui a sacralisé l’état de langue qui est le sien et qui confond la langue et l’orthographe. L’Académie française, instituée pour codifier la langue plus que pour la régenter, a aussitôt émis des objections solennelles. C’est la même Académie qui pousse des cris d’orfraie dès que l’on propose de supprimer la règle d’accord du participe passé (qui se prononce de la même manière, sauf chez quelques personnes, dans « le roman que j’ai aimé » et « les Romaines que j’ai aimées »), la suppression des –h – inutiles comme le font depuis longtemps les Italiens qui écrivent biblioteca, faraone sans qu’on ait constaté une baisse de leur niveau intellectuel, et qui maintiennent qu’il faut écrire « il chante, ils chantent » alors que ces mots se prononcent exactement de la même manière et que dans le discours oral personne ne les confond jamais : le contexte fait la différence. Les linguistes ont beau montrer depuis deux siècles que la langue, c’est la langue parlée, et que la langue écrite n’en est que le vêtement, la sacralisation de l’écriture persiste même chez les petites gens et malheureusement aussi chez beaucoup de gens cultivés. Savent-ils seulement que cet article qu’ils lisent en alphabet latin a été écrit sur un ordinateur par des séquences de 0 et 1 ?
L’écriture inclusive, dont on a tant parlé, au point que le Ministre de l’Éducation nationale a jugé bon de l’écarter de façon solennelle, n’est qu’un système d’abréviations. On aura beau écrire « Français.e.s », les hommes politiques devront toujours commencer leur discours en disant
« Français, Françaises » s’ils veulent être compris. Arlette Laguiller aurait pu écrire « Travailleu.r/se.s », elle l’aurait lu « Travailleurs, travailleuses ». Conformément à ce qu’exprime la deuxième règle mise en cause, lorsque dans un discours il faudra mentionner tous ceux qui travaillent dans la boucherie, l’éducation ou les hôpitaux, quoi qu’en disent les féministes, il faudra choisir entre être long (bouchers et bouchères, éducateurs et éducatrices, infirmiers et infirmières) ou être rhétoriquement efficace et utiliser le masculin pluriel car c’est l’usage : le mot « bouchers », selon les cas, inclut ou n’inclut pas les bouchères. Parfois, dans le cas des professions très féminisées, c’est le féminin qui l’emporte : on parlera des infirmières et des sage-femmes bien que des hommes occupent aussi ces emplois. Dans d’autres cas, quand le mot masculin a une terminaison féminine, la distinction est impossible à faire, sauf à ajouter un suffixe malsonnant (maire/mairesse, Corses/Corsesses) ou la mention « hommes et femmes » (saltimbanques, commissaires hommes et femmes ou de tout sexe etc.).
Ce que les féministes et les Académiciens méconnaissent, c’est que la langue n’est pas instituée par les grammairiens, ceux-ci ne font que noter l’usage dominant et l’école essaie de l’imposer. Mais la prononciation des mots et en conséquence les règles de l’accord grammatical oral sont le résultat d’une très longue évolution, bien antérieure même au latin que le français continue, qui a été rarement consciente et qui est surtout tributaire de l’usure phonétique, de l’analogie, de l’euphonie et d’un besoin instinctif d’unifier les usages en généralisant la forme la plus utilisée par les locuteurs. On n’efface pas des millénaires d’évolution par une pétition.
Le vocabulaire est beaucoup plus malléable. Le lexique de chaque langue chaque année s’enrichit de mots nouveaux et s’appauvrit de mots en désuétude. C’est pourquoi les féministes ont réussi à imposer une forme féminine pour les mots qui, phonétiquement, acceptent sans difficulté l’adjonction d’un suffixe féminin (avocat/avocate, instituteur/institutrice etc.) ou d’un article au féminin (la Ministre). Pour d’autres, c’est plus difficile (maire/mairesse ?, professeur/professeuse ? l’auteure n’est féminin qu’à l’écrit). Mimi Pinson n’est pas près de devenir Mimi Pinsonne. L’évolution de la société décidera. Le jour où une nette majorité de maires sera des femmes, on jugera peut-être bon de dire « les maires, y compris les maires hommes ». Mais il est probable que longtemps encore, en voyant une foule (féminin), on dise spontanément, qu’on soit allé à l’école ou non, « ils sont venus nombreux ». Et il restera toujours des expressions toutes faites, historiquement compréhensibles et logiquement irrationnelles, comme « la mère patrie », qui est le pays de nos très masculins pères.
Le vocabulaire est d’autant plus aisément sensible à la volonté humaine que le mot exprime une chose, une idée, un objet parfois imaginaire. Quand ce qu’il représente disparaît, le mot ne subsiste plus que dans les vieux dictionnaires ou change de sens. Les modernes chars ne servent plus à transporter les épis moissonnés, ils portent des canons et leurs roues sont des chenilles. L’emprunt n’est pas un signe de dégénérescence de la langue, seulement celui d’un retard technique ou d’une infériorité politique. L’usage de vocables anglo-saxons dans le monde du sport, de l’informatique, de la banque et du commerce traduit la supériorité américaine en ces domaines, mais les structures linguistiques du français tiennent. Les matchs de basket- ball (trois mots anglo-saxons) se commentent toujours en français. Plus dangereux est le langage de la publicité qui délibérément se passe des structures grammaticales usuelles.
Cette souplesse du vocabulaire, qui exige toujours, pour être précis, d’être clairement défini, permet toutes les manipulations. La plus évidente est l’euphémisation, censée rendre acceptable ce que de prime abord on est tenté de rejeter. Le Ministère de la Guerre devient le Ministère de la Défense, mieux encore de la Défense nationale ; les victimes civiles sont des dégâts collatéraux ; les guerres de type colonial des opérations de maintien de l’ordre ; la police et l’armée ne tuent plus, elles neutralisent etc. Plus insidieuse est la subversion volontaire du vocabulaire. La droite s’est approprié des mots comme nation, révolution et liberté. La liberté des révolutionnaires de 1789, qui s’inspirait de la liberté du citoyen grec et du citoyen romain et définissait un statut personnel au point qu’elle s’opposait à la liberté d’association (Loi Le Chapelier de 1791), est devenue par l’adjonction de quelques mots (liberté d’entreprendre, liberté du commerce) la meilleure justification idéologique du capitalisme le plus cynique (celui d’Amazon et d’Uber entr’autres) et le libéralisme, de doctrine politique, est devenu doctrine économique. Les écoles libres sont en très grande majorité des écoles étroitement contrôlées par la hiérarchie catholique ou le rabbinat. Inversement le mot peuple a perdu de son prestige au point que désormais satisfaire, ou vouloir satisfaire, les aspirations du peuple, c’est faire du populisme.
Le mot laïcité a subi un sort analogue. L’idée de laïcité a trouvé son expression aboutie dans la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État à laquelle on se réfère toujours aujourd’hui. Il suffit d’en lire le début, intitulé « Principes », pour constater qu’elle concerne uniquement les institutions religieuses. Elle acte la rupture institutionnelle entre un État dont les dirigeants sont démocratiquement élus et des organisations religieuses se réclamant de la loi divine(1). La loi est rédigée en termes généraux et s’applique à toutes les confessions. Mais en 1905, chacun savait que la seule Église visée était l’Église catholique, soumise à une puissance étrangère (le Pape) et qui s’opposait systématiquement aux mesures prises par la République et à la notion même de République. De religion, pas question. La loi parle de cultes, c’est-à-dire de cérémonies qui exigent un décor minimum (bâtiment ou estrade provisoire, cierges, fleurs, haut-parleurs etc.) et un personnel (prêtres, bedeaux, sacristains etc.). Ni l’un ni l’autre ne seront désormais financés par l’État.
Les croyants ne sont pas visés. La loi leur garantit la liberté de conscience, c’est-à-dire le libre choix de leurs croyances sans que l’État n’intervienne, mais aussi la protection de l’État contre quiconque les attaquerait car en désaccord avec leurs croyances ou leur incroyance. C’est en raison de cet article 1 que la République protège les mosquées, les synagogues, les loges maçonniques etc. et qu’arracher sa cornette à une bonne sœur ou maculer la soutane d’un curé (certains la portent encore) est susceptible de poursuites judiciaires. La liberté de conscience autorise aussi le recrutement par l’État d’ecclésiastiques et de religieuses à condition que ceux-ci ne fassent pas état de leurs convictions religieuses dans leur conduite, leur costume et leur parole quand ils sont en service. Les croyants sont si peu visés que dès son article 2, la loi donne la possibilité de payer sur le budget de l’État, des communes et des départements les aumôneries dont elle permet l’installation dans les lieux dont on ne peut sortir facilement pour assister au culte de son choix (internats, prisons etc.).
Depuis 1905, la France a beaucoup changé. Le manque d’enseignants (c’est en tout cas le prétexte mis en avant) a servi d’argument à la droite pour salarier les enseignants des écoles libres (essentiellement catholiques) à condition que le contenu de l’enseignement soit quasi-laïque et suive les programmes de l’école publique (loi Debré du 31 décembre 1959). Le manque de main d’œuvre à la fin de la deuxième guerre mondiale a entraîné un afflux de main d’œuvre immigrée importée des possessions coloniales de la France, souvent de confession musulmane. Cet afflux s’est augmenté, avec la fin des guerres coloniales, d’une immigration africaine fuyant la pauvreté, elle aussi majoritairement musulmane. Se sont ajoutés à cela le retour des pieds-noirs, souvent très hostiles à l’islam, et le conflit israëlo- palestinien. De la France très majoritairement catholique de 1905, mais avec bon nombre d’anticléricaux et de libres-penseurs, on est passé à une France multi-confessionnelle où islam rime avec immigration récente, pauvreté et conflits politico-raciaux. D’où la nécessité, pour éviter les conflits, de transformer la neutralité de l’État en neutralité de l’espace public, y compris à l’intérieur des entreprises privées. En pratique toutes les mesures prises visaient directement ou indirectement la population immigrée de confession musulmane et spécialement sa partie la moins éduquée. Bien qu’elles fussent justifiées par le maintien de la paix publique, elles furent demandées au nom de la laïcité et du respect de l’esprit de la loi de 1905. Or celle-ci ne concerne que la neutralité de l’État et ne dit rien de l’espace public. Jamais personne n’a songé à interdire le port de la soutane ni celui de la calotte. Les femmes catholiques mettaient un foulard avant d’aller à la messe, ou plutôt le gardaient car elles sortaient toujours la tête couverte, et souvent le visage dissimulé par une voilette : sortir « en cheveux » était la marque des femmes de mauvaise vie. Le mot de laïcité, parce que depuis 1905 il est devenu synonyme en France d’outil de maintien de la concorde nationale et de la paix publique, a été plus ou moins sciemment détourné de son sens premier pour être utilisé contre les musulmans en obtenant une caution de gauche. L’islam est combattu au nom de la laïcité par tous ceux que l’islam effraie, y compris l’Église catholique qui, après avoir longtemps combattu la loi de 1905, l’a acceptée du bout des lèvres en 1924 et en est maintenant un très chaud partisan(2).
Ce n’est pas que l’Église se soit de cœur ralliée à la laïcité, c’est qu’elle voit dans la loi de 1905 telle qu’elle est aujourd’hui appliquée le maintien de ses avantages acquis. En 1905 déjà l’Église catholique avait été attaquée dans ses privilèges, pas dans ses fondements. Saint-Etienne, Saint-Emilion ont gardé leur nom catholique. Jusqu’en 1966 les seuls prénoms admis par l’état-civil étaient, à de rares exceptions près, les prénoms catholiques (noms de baptême)(3). Le calendrier civil est resté pour l’essentiel le calendrier catholique. Les fêtes religieuses chrétiennes sont restées des jours fériés, y compris l’Assomption (15 août) que les protestants ne reconnaissent pas. Une demi-journée de la semaine a été laissée libre de cours pour que les enfants puissent suivre les cours de catéchisme (être endoctrinés, disaient les anti-cléricaux). Aucune école catholique ne fut fermée. Et bien sûr aucun catholique mâle ne fut privé du droit de vote et d’accès à toute profession. La France restait une société catholique pour l’essentiel.
La première guerre mondiale imposa des concessions de part et d’autre au nom de l’Union Nationale. Depuis 1924, et plus encore à partir de 1958 (vote de la loi Debré), les liens entre l’Église catholique et la République française se sont beaucoup resserrés. Le nonce du pape est, de droit, doyen du corps diplomatique. Les évêques sont souvent vus aux réceptions de l’Élysée. Les magistrats publics qui jusque dans les années 1960 s’abstenaient de se montrer dans les lieux de culte s’y font photographier comme M. Macron sur les marches de l’église de la Madeleine et dans celle-ci pendant les funérailles de Johnny Hallyday. Le Président de la République accepte toujours d’être chanoine de Latran et se fait représenter lors des cérémonies de béatification de catholiques français. Les écoles catholiques sont en grande partie financées par l’État aux prix de quelques concessions que de toute façon l’évolution politique et le progrès scientifique auraient imposées. Les édifices de culte bâtis avant 1905 sont entretenus par les communes ou l’État. Celui-ci ferme les yeux sur les violations flagrantes de la laïcité : il a fallu que le Conseil d’État rappelle le droit, à la suite de plaintes d’associations, pour que les crèches fussent retirées des bâtiments publics(4). Nos ambassadeurs ont le devoir de protéger les chrétiens, spécialement les catholiques, dans les pays où ils sont nommés et ne se privent pas d’assister aux messes, même lorsqu’ils sont incroyants. La politique de la France au Proche-Orient reste l’héritière du droit de protection des chrétiens maronites du Liban arraché à l’Empire ottoman en 1861. Surtout, scandale dont personne ne parle et dont même le Parti socialiste, jadis pro-laïque et parfois même anti-clérical, s’accommode fort bien, dans les trois départements d’Alsace-Lorraine la loi de 1905 ne s’applique pas, la République salarie les ministres des cultes reconnus (catholique, protestant, juif), l’enseignement religieux est obligatoire (sauf, jusqu’en 2017, à demander dispense) et assuré par des professeurs spéciaux, désignés par leur Église, et payés pour cela par l’État. Les facultés de théologie protestante et catholique forment aux frais de l’État des ministres du culte pour toute la France et pour les pays francophones. On comprend que l’Église catholique et la droite catholique applaudissent à cette conception de la laïcité et considèrent désormais que le christianisme et cette laïcité font tous deux (le masculin l’emporte sur le féminin) partie d’une prétendue identité française et qu’elles la définissent. On comprend aussi que les musulmans, même non fanatiques, devant cette inversion de sens, crient au double langage et se sentent discriminés par l’État. Les plus extrémistes en profitent pour attaquer dans leur principe la laïcité et la démocratie au nom d’une foi selon laquelle tout pouvoir vient de Dieu et de ceux qui prétendent parler en Son Nom. C’était la position de l’Église catholique de France jusqu’au milieu du 20e siècle. Elle n’est pas allée jusqu’à prôner le terrorisme, mais sa hiérarchie, dans grande majorité, s’est ralliée avec enthousiasme à Pétain.
Quant aux laïques qui demandent simplement le retour à l’esprit de la loi de 1905 (vox clamans in deserto), on les déconsidère en utilisant un autre artifice langagier, l’injure qui coupe court à toute discussion : ce sont des laïcards, partisans d’une laïcité radicale et même radicalisée. Esope avait raison, la langue est bien la meilleure et la pire des choses.
Gérard Fussman
~~~
(1) Article 1 : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. Article 2 : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes.
Pourront toutefois être inscrites aux dits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
(2) http://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et- declarations/368451-leglise-catholique-et-la-loi-du-9-decembre-1905-cent-ans-apres et eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/368623- rapports-de-leglise-catholique-avec-les-etats-principes-et-modalites.
(3) Loi du 11 germinal an XI:
« … les noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus dans l’histoire ancienne pourront seuls être reçus, comme prénoms, sur les registres de l’état civil destinés à constater la naissance des enfants; et il est interdit aux officiers publics d’en admettre aucun autre dans leurs actes. »
(4) La crèche est un élément du culte chrétien, surtout catholique, de Noël, pas le sapin.