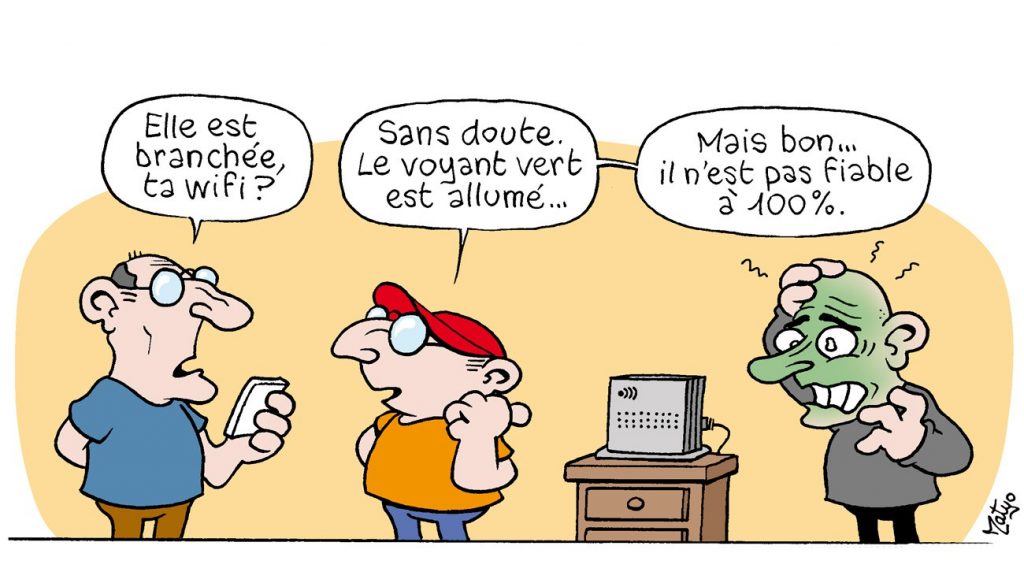Après Copenhague
Le bureau de l’Union rationaliste présente à tous les adhérents, à tous les visiteurs du site, ses meilleurs vœux pour l’année 2010. Ceux que nous formons pour le renforcement de notre association sont à la mesure de notre conviction : la lutte contre les irrationalismes et pour la laïcité, l’effort de refondation des rapports de la science et de la société, le développement d’une culture humaniste intégrant la science dans la culture générale, sont plus que jamais indispensables aujourd’hui. Le rationalisme n’est pas un dogme, mais le moyen d’aborder de manière constructive les grandes questions de société…